11 août 2010
Pourquoi il faut partager les revenus - Artus/Virard
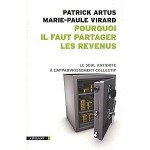 Patrick Artus, économiste et directeur de recherche de Natixis, et Marie-Paule Virard, journaliste économique indépendante, sont des prolifiques auteurs d’essais économiques « grand public » et prospectif : Le capitalisme est en train de s’autodétruire (2005), Globalisation, le pire est à venir (2008), Est-il trop tard pour sauver l’Amérique ? (2009). Pourquoi il faut partager les revenus est leur dernier ouvrage. Le titre est éloquent. C’est un intervenant sur le blog de Moscovici qui m’a donné envie de le lire.
Patrick Artus, économiste et directeur de recherche de Natixis, et Marie-Paule Virard, journaliste économique indépendante, sont des prolifiques auteurs d’essais économiques « grand public » et prospectif : Le capitalisme est en train de s’autodétruire (2005), Globalisation, le pire est à venir (2008), Est-il trop tard pour sauver l’Amérique ? (2009). Pourquoi il faut partager les revenus est leur dernier ouvrage. Le titre est éloquent. C’est un intervenant sur le blog de Moscovici qui m’a donné envie de le lire.
Dès l’introduction, les auteurs posent le cadre : la crise de 2007-2009 n’est pas une simple parenthèse, mais plutôt le point de départ d’une nouvelle phase de la globalisation. Cette nouvelle phase, qu’ils appellent « déglobalisation », serait marquée par le dynamisme autonome des pays émergents et la stagnation des économies occidentales, qui rencontrent les plus grandes difficultés à se réformer, et leur recul dans l’économie mondiale (I). Confrontés à un risque de spirale déflationniste à la japonaise (II), les économies développées ne peuvent plus compter sur les politiques économiques classiques aux effets limités, voir contreproductifs (III). La France peut s’en sortir en modifiant le partage des revenus entre salaires et profits (IV), mais surtout en œuvrant pour que se mette en place une véritable solidarité européenne (V).
Un nouveau contexte : la déglobalisation.
La déglobalisation est défini par les auteurs non pas comme la fin de l’ouverture économique et financière ou un retour du protectionnisme (retour perceptible dans certains combats douaniers ou dans le retour du contrôle des capitaux[i]) mais comme une situation où les échanges commerciaux sont moins dynamiques qu’avant la crise
L’économie internationale connait une évolution décisive, véritable menace pour les « vieux pays » : les pays émergents, où la demande intérieure est déjà repartie, substituent de plus en plus la production domestique aux importations. Il est illusoire pour les pays de l’OCDE d’espérer un soutien de leur croissance par la demande des pays émergents (soit nos exportations).
La part des pays émergents dans le commerce international augmente très rapidement : avec 12% du commerce mondial, la Chine est devenue le premier pays exportateur mondial. Par ailleurs, les économies émergentes sont passées d’une spécialisation « bas de gammes » à une spécialisation « haut de gammes ». La Chine par exemple a vu ses produits hauts de gammes passer de 21% des exportations chinoises en 1998, à 33% dix ans plus tard.
Cette montée en gamme s’explique par la diffusion de l’innovation depuis les entreprises étrangères, par le rôle de l’Etat (soutient aux industries de hautes technologiques), par le développement de l’éducation supérieure (on est passé de 2 millions de diplômés universitaires en 1982 à 80 en 2007), et par l’augmentation rapide de la productivité globale des facteurs (1999-2009 : une moyenne de 3,5% par an).
L’année 2010 devrait marquer le basculement du centre de gravité de l’économie mondiale vers les pays émergents. A eux seuls, les BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) représentent 50% de la croissance de la consommation mondiale. C’est la consommation domestique qui va constituer le moteur du dynamisme économique des pays émergents. Ces derniers vont tôt ou tard passer d’un modèle mercantiliste de croissance à un modèle de croissance basé sur la demande intérieure (développement rapide des classes moyennes et aisées).
Ce changement de modèle de croissance n’est pas sans conséquences pour les économies de l’OCDE, condamnées à une croissance durablement faible (le désendettement des ménages et entreprises, la multiplication de plans réduction des déficits publics et la faiblesse de l’emploi entretiennent une demande intérieure morose) et atteint par le phénomène de désindustrialisation (la France a perdu près de 2 millions d’emplois industriels depuis 1980, dont 500 000 perdus entre 2000 et 2008[ii]).
Les pays de l’OCDE devront faire face d’une part à une hausse des prix des matières premières (pétrole, plomb, argent, étain, zinc), conséquence de l’amélioration de l’activité industrielle des pays émergents et de l’excès de liquidité mondiale, et d’autre part à une hausse probable des taux d’intérêts à long terme qui devrait alourdir le poids de la dette.
Plus important encore, ce changement de modèle de croissance devrait modifier le régime de changes de certaines économies émergentes. Certaines stabilisent leurs monnaies par rapport au dollar pour conserver leur compétitivité prix, se privant par là même de l’outil monétaire. Par exemple, le lien fixe entre le dollar et le yuan empêche l’utilisation par la Chine de la politique monétaire comme instrument de régulation du taux d’intérêt et de contrôle de la création monétaire ou encore de la distribution du crédit.
Ainsi, la Chine soutient la monnaie américaine. Lorsque celle-ci se déprécie, la Banque centrale de Chine achète des dollars et crée ex-nihilo sa monnaie et acquiert des actifs en dollars sur le marché. Si les autorités chinoises décidaient de laisser flotter leur monnaie, les conséquences seraient sérieuses pour la zone euro et les Etats-Unis : d’une part, la dépréciation du dollar et de l’euro vis-à-vis des devises des pays émergents provoquerait une hausse des prix importés, donc une détérioration des termes de l’échange, et d’autre part, une augmentation des taux d’intérêt de long terme susceptible d’aggraver la dépression de la demande.
Prise dans sa dimension financière, la déglobalisation devrait conduire chaque région à ne compter que sur sa propre épargne pour financer sa croissance. Or l’épargne domestique des pays de l’OCDE est insuffisante. C’est l’épargne des pays émergents qui a financé tout au long des années quatre vingt dix les déficits publics américains et européens et l’endettement privé de ces mêmes zones. La déglobalisation financière va marquer la fin des conditions de financement très favorables pour les économies de l’OCDE.
Le spectre de la maladie japonaise : le risque de stag-déflation.
Le choc qui a déclenché la crise (excès d’endettement associé à des bulles sur les prix des actifs, crise bancaire lorsque les bulles éclatent, désendettement durable qui réduit la demande, inflation très faible qui fait monter les taux d’intérêts réels, freinage ou même recul des salaires) ressemble furieusement à celui ayant initié la dynamique déflationniste qui sévit le Japon depuis le début des années 1990.
A la fin des années quatre vingt, le Japon jouissait d'une grande prospérité économique, et enregistrait d’importants excédents commerciaux. Toutefois, en raison d’une politique monétaire accommodante, le surplus de liquidité engendré a fait progresser le niveau de crédit et le prix des actifs. L’indice du NIKKEI est passé de 13 000 à 39 000 points en trois ans, et les prix de l’immobilier ont augmenté de 60% pour la seule année 1989. La spéculation financière et immobilière était bien présente.
C’est la remontée des taux d’intérêt pour faire face au retour de l’inflation (conséquence de la tension sur le partage de la valeur ajoutée, du vieillissement, de la surchauffe économique) qui a provoqué le retournement économique et l’explosion de la bulle immobilière et financière. S’en est suivi un effondrement de la bourse et des prix des actifs et la multiplication des faillites bancaires.
Le Japon est alors entré dans un équilibre déflationniste : un taux d’inflation inférieur à zéro et une politique monétaire pro-cyclique. Celle-ci signifie que, plus les prix baissent avec la demande, plus les taux d’intérêts réels augmentent. En conséquence, les ménages et les entreprises sont alors prêts à tout pour préserver leur niveau de profitabilité (pression sur salaires, solder les stocks).
Ni la baisse des taux d’intérêt, ni les plans de relance ne viennent renverser la situation. Malgré deux plans de relance pour la seule année 2009 – celui de septembre 2009 (92 300 milliards de Yen soit 704 milliards d’euros) et celui du 7 décembre 2009 (7200 milliards de Yen soit 1,5 point de PIB) – la récession était de 5,7% en 2009. La croissance japonaise moyenne entre 1992 et 2008 était inférieure à 2%.
Afin de satisfaire les actionnaires très exigeants sur le rendement du capital et de préserver des capacités d’autofinancement au moment où l’épargne privée est confisquée pour le financement des déficits publics, les entreprises cherchent à diminuer les salaires. Résultats : destruction des capacités de production, délocalisation et pertes d’emplois (-20% sur 10 ans), dette publique atteignant presque 200% du PIB.
L’hypothèse d’un scénario déflationniste à la japonaise pour la zone euro et les Etats-Unis n’est pas à exclure.
La chute des prix d’actifs a conduit à un recul de l’inflation et au frein sur les salaires, ce qui pèse sur la consommation et la demande. Et comme l’épargne est captée par le financement des déficits publics, on enregistre une baisse des investissements privés et des salaires nominaux (baisse du temps de travail, baisse en général du salaire, multiplication du temps partiel), qui maintient la faiblesse de la demande.
Les limites des politiques économiques classiques
|
| Zone euro | France | Japon | USA | Royaume-Uni |
| Déficit public | 6,3% | 7,9% | 8% | 9,9% | 12,9% |
| Dette publique | 78,8% | 77,2% | 1832% | 53,% | 73,2% |
Entre 1998 et 2007, les pays de l’OCDE ont sauvé leur croissance via le développement du crédit (qui a remplacé le revenu, laminé par la globalisation) permis par une politique monétaire expansionniste. Il a été calculé que sans l’endettement du secteur privé, la croissance aurait été environ de 2% aux USA (contre 4%) et de 1% dans la zone € (contre 2-3%).
Vertus et limites des déficits.
Lorsque le crédit a été coupé, la part de la demande privé financée par le crédit s’est évaporé (biens des ménages, investissements pour les entreprises ou développement du commerce international) d’où le recours à des plans de relance massifs. Mais si la relance budgétaire (sous forme de baisse d’impôt ou d'augmentation de la dépense) a permis un redémarrage de la consommation[iii], il faut creuser toujours plus le déficit pour augmenter l’activité (effet dynamique).
Or l’effet normalement positif du déficit budgétaire (logique du multiplicateur keynésien) est atténué voir anesthésié par le phénomène d’anticipation des agents économiques : l’épargne de précaution (tout hausse du déficit dans le présent non compensé par des impôts immédiats est perçu comme des impôts futurs, les ménages préfèrent alors épargner en prévision des futurs prélèvements). Le taux d’épargne des ménages français est ainsi remonté à 17%.
La monétisation des déficits publics, un engrenage diabolique.
Sachant que les besoins de financement public étaient supérieurs à ce que les investisseurs privés (banques, assurances, fonds d’investissements) étaient prêts à financer en achetant des titres publics sur les marchés, les banques centrales n’ont pas hésité à organiser le rachat (ou la prise en pension) par les banques de titres publics avec en contre partie, une création monétaire ex-nihilo (les banques centrales achètent obligations émises par les administrations qui reçoivent en échange de quoi financer leurs dépenses).
En situation d’insuffisance de la demande mondiale (sous-emploi), d’excès d’épargne et de faiblesse de l'inflation, on peut supporter une politique économique expansionniste. Mais la base monétaire a encore augmenté (+30%), ce qui laisse entrevoir de nouvelles bulles spéculatives en formation (ex : sur le cuivre, le sucre, l’or, l’immobilier du luxe etc).
La guerre des taux de change est devant nous.
La guerre des taux de change est une tentative de gagner des parts de marché en sous évaluant la monnaie. Avec un dollar faible comme ce fut le cas entre 1994 et 1999, puis entre 2005 et 2008, le commerce extérieur américain s’était amélioré.
Mais lorsque le dollar baisse, le yen et l’euro subissent l’essentiel de l’ajustement alors que ces économies sont déjà en déflation (Japon) ou connaissent un important risque de déflation (zone euro). Ce faisant les américains améliorent leur compétitivité (moins dépendant de la demande intérieure) et transfèrent les risques déflationnistes sur des pays à devises flexibles et à faible autorité politique.
Un nouveau partage, l’antidote à l’appauvrissement collectif.
Artus et Virard appellent à en finir avec un modèle de capitalisme qu’ils jugent exténué. Ce modèle, fondé sur la gestion des entreprises au profit des actionnaires, la faiblesse des salaires mal compensée par le crédit et le développement de création d’emplois dans les secteurs liés au crédit (distribution, construction), fait des salaires la variable d’ajustement privilégiée.
La déformation du partage de la valeur ajoutée entre salaires et profits qu’on observe depuis une vingtaine d’années devrait non seulement durer mais s’amplifier. En effet, quand il y a moins de richesse créée, le conflit sur sa répartition augmente : l’Etat voit ses recettes fiscales diminuer, les entreprises voient leurs profits baisser et les ménages voient diminuer le nombre d’emploi et le niveau de salaire.
Or les entreprises doivent faire face à une croissance plus faible de leur activité et satisfaire les exigences de leurs actionnaires, ce qui accentue la pression sur les salaires. Les exigences des actionnaires sont d’autant plus fortes que la politique monétaire est accommodante : l’excès de liquidité fait que l’argent devient bon marché, ce qui encourage la spéculation, donc l’investissement boursier.
Artus et Virard proposent alors d’infléchir le partage en faveur des revenus dépensés.
Réformer la fiscalité :
- Diminuer la pression fiscale sur le travail (baisse des charges sociales) compensée par une hausse de la pression fiscale sur les revenus du capital.
- Augmenter les salaires bas et moyens via un transfert prélevés sur les profits non investis et les revenus du capital non dépensés.
- Harmoniser la taxation des plus values en capital à court terme au niveau international
Modérer l’exigence de rendement du capital des investisseurs :
- Les pouvoirs publics doivent jouer leur rôle d’actionnaire avec un objectif de rentabilité inférieur à la norme privée (via la Caisse des Dépôts et des Consignations et le Fond Stratégique d’Investissement – doté de 14 milliards d’euros – tout en laissant la sélection des projets au secteur privé).
- Modifier les normes comptables (IAS) et prudentielles (Solvency II) afin que les investisseurs de long terme puissent investir davantage dans le capital des entreprises.
Stimuler la demande via la baisse des prix : faire disparaitre les rentes d’oligopoles (barrières à l’entrée)
Mener une politique spécifique d’emploi ciblé sur les jeunes :
- Lutter contre le chômage des jeunes via la formation et l’apprentissage en alternance
- Mettre en place des quotas d’embauche pour les jeunes diplômés (contrat en alternance etc)
L’impératif de solidarité européenne.
Toute union monétaire est une machine à fabriquer de la divergence entre économies dès lors qu’il n’existe aucun mécanisme stabilisateur susceptible d’absorber les chocs pouvant affecter tel ou tel pays (dit choc asymétrique).
L’union monétaire n’est une zone monétaire optimale définie par Robert Mundell selon deux conditions : il ne doit pas avoir de chocs asymétriques, et les facteurs de production (travail et capital) doivent circuler librement.
En l’absence de politique concertée sur le plan social (marché du travail), budgétaire ou fiscal, chaque Etat membre a mis en œuvre une politique économique et industrielle qu’il considérait comme la plus conforme à ses intérêts.
Cela a produit des spécialisations productives différentes : c’est le cas de l’Allemagne et de l’Espagne.
| Allemagne | Espagne |
| Modèle axé sur la compétitivité-coût, l’industrie haut de gamme, et le dynamisme des exportations. Cela a conduit à une compression des coûts salariaux et à une politique de désinflation compétitive menée au détriment des autres Etats membres de la zone. | Modèle centré sur le dynamisme du secteur de la construction et de celui du tourisme. Pauvre en gains de productivité et marqué par un fort endettement des ménages. Bons « ratios » : excédent budgétaire (2% du PIB), forte croissance (4%), créations d’emplois et rattrapage salarial. |
La politique monétaire n’a pas été sans effet :
- Lorsque le taux de croissance > taux d’intérêt => économie stimulée (endettement, hausse prix des actifs)
- Lorsque le taux de croissance < taux d’intérêt => situation inversée
A l’heure actuelle, la zone euro ne peut revendiquer une mobilité totale du facteur travail ou l’existence d’une solidarité budgétaire (système de redistribution des prestations sociales). Le budget communautaire est très faible (1,1% du PIB) et les traités n’autorisent pas d’aides directes entre les Etats (no bail out).
Leurs propositions pour une solidarité européenne :
- Etablir un dispositif d’aide mutuelle (l’accord du 25 mai 2010 est un premier pas en la matière)
- Afficher des objectifs réalistes de réduction des déficits publics sans casser la reprise.
- Mettre sur pieds une supervision macroprudentielle
- Faire converger les économies par rapprochement des législations fiscales et sociales.
[i] Le Brésil a fixé un taux d’entrée des capitaux à 2 %
[ii] Les disparitions d’emplois dans l’industrie serait pour 25% du au phénomène de tertiarisation, 30% du aux gains de productivité, et 45% à la concurrence étrangère.
[iii] Sans transfert public, le revenu consommable américain aurait été inférieur de 9% à celui dont les ménages américains ont disposés en 2009
00:04 Publié dans Livres | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : économie, moscovici




Commentaires
En parlant de déflation...
http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/08/11/aux-etats-unis-la-fed-s-alarme-de-l-essoufflement-de-la-reprise_1397786_3234.html
Écrit par : Pablo | 11 août 2010
Les commentaires sont fermés.