11 août 2010
Pourquoi il faut partager les revenus - Artus/Virard
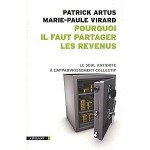 Patrick Artus, économiste et directeur de recherche de Natixis, et Marie-Paule Virard, journaliste économique indépendante, sont des prolifiques auteurs d’essais économiques « grand public » et prospectif : Le capitalisme est en train de s’autodétruire (2005), Globalisation, le pire est à venir (2008), Est-il trop tard pour sauver l’Amérique ? (2009). Pourquoi il faut partager les revenus est leur dernier ouvrage. Le titre est éloquent. C’est un intervenant sur le blog de Moscovici qui m’a donné envie de le lire.
Patrick Artus, économiste et directeur de recherche de Natixis, et Marie-Paule Virard, journaliste économique indépendante, sont des prolifiques auteurs d’essais économiques « grand public » et prospectif : Le capitalisme est en train de s’autodétruire (2005), Globalisation, le pire est à venir (2008), Est-il trop tard pour sauver l’Amérique ? (2009). Pourquoi il faut partager les revenus est leur dernier ouvrage. Le titre est éloquent. C’est un intervenant sur le blog de Moscovici qui m’a donné envie de le lire.
Dès l’introduction, les auteurs posent le cadre : la crise de 2007-2009 n’est pas une simple parenthèse, mais plutôt le point de départ d’une nouvelle phase de la globalisation. Cette nouvelle phase, qu’ils appellent « déglobalisation », serait marquée par le dynamisme autonome des pays émergents et la stagnation des économies occidentales, qui rencontrent les plus grandes difficultés à se réformer, et leur recul dans l’économie mondiale (I). Confrontés à un risque de spirale déflationniste à la japonaise (II), les économies développées ne peuvent plus compter sur les politiques économiques classiques aux effets limités, voir contreproductifs (III). La France peut s’en sortir en modifiant le partage des revenus entre salaires et profits (IV), mais surtout en œuvrant pour que se mette en place une véritable solidarité européenne (V).
Un nouveau contexte : la déglobalisation.
La déglobalisation est défini par les auteurs non pas comme la fin de l’ouverture économique et financière ou un retour du protectionnisme (retour perceptible dans certains combats douaniers ou dans le retour du contrôle des capitaux[i]) mais comme une situation où les échanges commerciaux sont moins dynamiques qu’avant la crise
L’économie internationale connait une évolution décisive, véritable menace pour les « vieux pays » : les pays émergents, où la demande intérieure est déjà repartie, substituent de plus en plus la production domestique aux importations. Il est illusoire pour les pays de l’OCDE d’espérer un soutien de leur croissance par la demande des pays émergents (soit nos exportations).
La part des pays émergents dans le commerce international augmente très rapidement : avec 12% du commerce mondial, la Chine est devenue le premier pays exportateur mondial. Par ailleurs, les économies émergentes sont passées d’une spécialisation « bas de gammes » à une spécialisation « haut de gammes ». La Chine par exemple a vu ses produits hauts de gammes passer de 21% des exportations chinoises en 1998, à 33% dix ans plus tard.
Cette montée en gamme s’explique par la diffusion de l’innovation depuis les entreprises étrangères, par le rôle de l’Etat (soutient aux industries de hautes technologiques), par le développement de l’éducation supérieure (on est passé de 2 millions de diplômés universitaires en 1982 à 80 en 2007), et par l’augmentation rapide de la productivité globale des facteurs (1999-2009 : une moyenne de 3,5% par an).
L’année 2010 devrait marquer le basculement du centre de gravité de l’économie mondiale vers les pays émergents. A eux seuls, les BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) représentent 50% de la croissance de la consommation mondiale. C’est la consommation domestique qui va constituer le moteur du dynamisme économique des pays émergents. Ces derniers vont tôt ou tard passer d’un modèle mercantiliste de croissance à un modèle de croissance basé sur la demande intérieure (développement rapide des classes moyennes et aisées).
Ce changement de modèle de croissance n’est pas sans conséquences pour les économies de l’OCDE, condamnées à une croissance durablement faible (le désendettement des ménages et entreprises, la multiplication de plans réduction des déficits publics et la faiblesse de l’emploi entretiennent une demande intérieure morose) et atteint par le phénomène de désindustrialisation (la France a perdu près de 2 millions d’emplois industriels depuis 1980, dont 500 000 perdus entre 2000 et 2008[ii]).
Les pays de l’OCDE devront faire face d’une part à une hausse des prix des matières premières (pétrole, plomb, argent, étain, zinc), conséquence de l’amélioration de l’activité industrielle des pays émergents et de l’excès de liquidité mondiale, et d’autre part à une hausse probable des taux d’intérêts à long terme qui devrait alourdir le poids de la dette.
Plus important encore, ce changement de modèle de croissance devrait modifier le régime de changes de certaines économies émergentes. Certaines stabilisent leurs monnaies par rapport au dollar pour conserver leur compétitivité prix, se privant par là même de l’outil monétaire. Par exemple, le lien fixe entre le dollar et le yuan empêche l’utilisation par la Chine de la politique monétaire comme instrument de régulation du taux d’intérêt et de contrôle de la création monétaire ou encore de la distribution du crédit.
Ainsi, la Chine soutient la monnaie américaine. Lorsque celle-ci se déprécie, la Banque centrale de Chine achète des dollars et crée ex-nihilo sa monnaie et acquiert des actifs en dollars sur le marché. Si les autorités chinoises décidaient de laisser flotter leur monnaie, les conséquences seraient sérieuses pour la zone euro et les Etats-Unis : d’une part, la dépréciation du dollar et de l’euro vis-à-vis des devises des pays émergents provoquerait une hausse des prix importés, donc une détérioration des termes de l’échange, et d’autre part, une augmentation des taux d’intérêt de long terme susceptible d’aggraver la dépression de la demande.
Prise dans sa dimension financière, la déglobalisation devrait conduire chaque région à ne compter que sur sa propre épargne pour financer sa croissance. Or l’épargne domestique des pays de l’OCDE est insuffisante. C’est l’épargne des pays émergents qui a financé tout au long des années quatre vingt dix les déficits publics américains et européens et l’endettement privé de ces mêmes zones. La déglobalisation financière va marquer la fin des conditions de financement très favorables pour les économies de l’OCDE.
Le spectre de la maladie japonaise : le risque de stag-déflation.
Le choc qui a déclenché la crise (excès d’endettement associé à des bulles sur les prix des actifs, crise bancaire lorsque les bulles éclatent, désendettement durable qui réduit la demande, inflation très faible qui fait monter les taux d’intérêts réels, freinage ou même recul des salaires) ressemble furieusement à celui ayant initié la dynamique déflationniste qui sévit le Japon depuis le début des années 1990.
A la fin des années quatre vingt, le Japon jouissait d'une grande prospérité économique, et enregistrait d’importants excédents commerciaux. Toutefois, en raison d’une politique monétaire accommodante, le surplus de liquidité engendré a fait progresser le niveau de crédit et le prix des actifs. L’indice du NIKKEI est passé de 13 000 à 39 000 points en trois ans, et les prix de l’immobilier ont augmenté de 60% pour la seule année 1989. La spéculation financière et immobilière était bien présente.
C’est la remontée des taux d’intérêt pour faire face au retour de l’inflation (conséquence de la tension sur le partage de la valeur ajoutée, du vieillissement, de la surchauffe économique) qui a provoqué le retournement économique et l’explosion de la bulle immobilière et financière. S’en est suivi un effondrement de la bourse et des prix des actifs et la multiplication des faillites bancaires.
Le Japon est alors entré dans un équilibre déflationniste : un taux d’inflation inférieur à zéro et une politique monétaire pro-cyclique. Celle-ci signifie que, plus les prix baissent avec la demande, plus les taux d’intérêts réels augmentent. En conséquence, les ménages et les entreprises sont alors prêts à tout pour préserver leur niveau de profitabilité (pression sur salaires, solder les stocks).
Ni la baisse des taux d’intérêt, ni les plans de relance ne viennent renverser la situation. Malgré deux plans de relance pour la seule année 2009 – celui de septembre 2009 (92 300 milliards de Yen soit 704 milliards d’euros) et celui du 7 décembre 2009 (7200 milliards de Yen soit 1,5 point de PIB) – la récession était de 5,7% en 2009. La croissance japonaise moyenne entre 1992 et 2008 était inférieure à 2%.
Afin de satisfaire les actionnaires très exigeants sur le rendement du capital et de préserver des capacités d’autofinancement au moment où l’épargne privée est confisquée pour le financement des déficits publics, les entreprises cherchent à diminuer les salaires. Résultats : destruction des capacités de production, délocalisation et pertes d’emplois (-20% sur 10 ans), dette publique atteignant presque 200% du PIB.
L’hypothèse d’un scénario déflationniste à la japonaise pour la zone euro et les Etats-Unis n’est pas à exclure.
La chute des prix d’actifs a conduit à un recul de l’inflation et au frein sur les salaires, ce qui pèse sur la consommation et la demande. Et comme l’épargne est captée par le financement des déficits publics, on enregistre une baisse des investissements privés et des salaires nominaux (baisse du temps de travail, baisse en général du salaire, multiplication du temps partiel), qui maintient la faiblesse de la demande.
Les limites des politiques économiques classiques
|
| Zone euro | France | Japon | USA | Royaume-Uni |
| Déficit public | 6,3% | 7,9% | 8% | 9,9% | 12,9% |
| Dette publique | 78,8% | 77,2% | 1832% | 53,% | 73,2% |
Entre 1998 et 2007, les pays de l’OCDE ont sauvé leur croissance via le développement du crédit (qui a remplacé le revenu, laminé par la globalisation) permis par une politique monétaire expansionniste. Il a été calculé que sans l’endettement du secteur privé, la croissance aurait été environ de 2% aux USA (contre 4%) et de 1% dans la zone € (contre 2-3%).
Vertus et limites des déficits.
Lorsque le crédit a été coupé, la part de la demande privé financée par le crédit s’est évaporé (biens des ménages, investissements pour les entreprises ou développement du commerce international) d’où le recours à des plans de relance massifs. Mais si la relance budgétaire (sous forme de baisse d’impôt ou d'augmentation de la dépense) a permis un redémarrage de la consommation[iii], il faut creuser toujours plus le déficit pour augmenter l’activité (effet dynamique).
Or l’effet normalement positif du déficit budgétaire (logique du multiplicateur keynésien) est atténué voir anesthésié par le phénomène d’anticipation des agents économiques : l’épargne de précaution (tout hausse du déficit dans le présent non compensé par des impôts immédiats est perçu comme des impôts futurs, les ménages préfèrent alors épargner en prévision des futurs prélèvements). Le taux d’épargne des ménages français est ainsi remonté à 17%.
La monétisation des déficits publics, un engrenage diabolique.
Sachant que les besoins de financement public étaient supérieurs à ce que les investisseurs privés (banques, assurances, fonds d’investissements) étaient prêts à financer en achetant des titres publics sur les marchés, les banques centrales n’ont pas hésité à organiser le rachat (ou la prise en pension) par les banques de titres publics avec en contre partie, une création monétaire ex-nihilo (les banques centrales achètent obligations émises par les administrations qui reçoivent en échange de quoi financer leurs dépenses).
En situation d’insuffisance de la demande mondiale (sous-emploi), d’excès d’épargne et de faiblesse de l'inflation, on peut supporter une politique économique expansionniste. Mais la base monétaire a encore augmenté (+30%), ce qui laisse entrevoir de nouvelles bulles spéculatives en formation (ex : sur le cuivre, le sucre, l’or, l’immobilier du luxe etc).
La guerre des taux de change est devant nous.
La guerre des taux de change est une tentative de gagner des parts de marché en sous évaluant la monnaie. Avec un dollar faible comme ce fut le cas entre 1994 et 1999, puis entre 2005 et 2008, le commerce extérieur américain s’était amélioré.
Mais lorsque le dollar baisse, le yen et l’euro subissent l’essentiel de l’ajustement alors que ces économies sont déjà en déflation (Japon) ou connaissent un important risque de déflation (zone euro). Ce faisant les américains améliorent leur compétitivité (moins dépendant de la demande intérieure) et transfèrent les risques déflationnistes sur des pays à devises flexibles et à faible autorité politique.
Un nouveau partage, l’antidote à l’appauvrissement collectif.
Artus et Virard appellent à en finir avec un modèle de capitalisme qu’ils jugent exténué. Ce modèle, fondé sur la gestion des entreprises au profit des actionnaires, la faiblesse des salaires mal compensée par le crédit et le développement de création d’emplois dans les secteurs liés au crédit (distribution, construction), fait des salaires la variable d’ajustement privilégiée.
La déformation du partage de la valeur ajoutée entre salaires et profits qu’on observe depuis une vingtaine d’années devrait non seulement durer mais s’amplifier. En effet, quand il y a moins de richesse créée, le conflit sur sa répartition augmente : l’Etat voit ses recettes fiscales diminuer, les entreprises voient leurs profits baisser et les ménages voient diminuer le nombre d’emploi et le niveau de salaire.
Or les entreprises doivent faire face à une croissance plus faible de leur activité et satisfaire les exigences de leurs actionnaires, ce qui accentue la pression sur les salaires. Les exigences des actionnaires sont d’autant plus fortes que la politique monétaire est accommodante : l’excès de liquidité fait que l’argent devient bon marché, ce qui encourage la spéculation, donc l’investissement boursier.
Artus et Virard proposent alors d’infléchir le partage en faveur des revenus dépensés.
Réformer la fiscalité :
- Diminuer la pression fiscale sur le travail (baisse des charges sociales) compensée par une hausse de la pression fiscale sur les revenus du capital.
- Augmenter les salaires bas et moyens via un transfert prélevés sur les profits non investis et les revenus du capital non dépensés.
- Harmoniser la taxation des plus values en capital à court terme au niveau international
Modérer l’exigence de rendement du capital des investisseurs :
- Les pouvoirs publics doivent jouer leur rôle d’actionnaire avec un objectif de rentabilité inférieur à la norme privée (via la Caisse des Dépôts et des Consignations et le Fond Stratégique d’Investissement – doté de 14 milliards d’euros – tout en laissant la sélection des projets au secteur privé).
- Modifier les normes comptables (IAS) et prudentielles (Solvency II) afin que les investisseurs de long terme puissent investir davantage dans le capital des entreprises.
Stimuler la demande via la baisse des prix : faire disparaitre les rentes d’oligopoles (barrières à l’entrée)
Mener une politique spécifique d’emploi ciblé sur les jeunes :
- Lutter contre le chômage des jeunes via la formation et l’apprentissage en alternance
- Mettre en place des quotas d’embauche pour les jeunes diplômés (contrat en alternance etc)
L’impératif de solidarité européenne.
Toute union monétaire est une machine à fabriquer de la divergence entre économies dès lors qu’il n’existe aucun mécanisme stabilisateur susceptible d’absorber les chocs pouvant affecter tel ou tel pays (dit choc asymétrique).
L’union monétaire n’est une zone monétaire optimale définie par Robert Mundell selon deux conditions : il ne doit pas avoir de chocs asymétriques, et les facteurs de production (travail et capital) doivent circuler librement.
En l’absence de politique concertée sur le plan social (marché du travail), budgétaire ou fiscal, chaque Etat membre a mis en œuvre une politique économique et industrielle qu’il considérait comme la plus conforme à ses intérêts.
Cela a produit des spécialisations productives différentes : c’est le cas de l’Allemagne et de l’Espagne.
| Allemagne | Espagne |
| Modèle axé sur la compétitivité-coût, l’industrie haut de gamme, et le dynamisme des exportations. Cela a conduit à une compression des coûts salariaux et à une politique de désinflation compétitive menée au détriment des autres Etats membres de la zone. | Modèle centré sur le dynamisme du secteur de la construction et de celui du tourisme. Pauvre en gains de productivité et marqué par un fort endettement des ménages. Bons « ratios » : excédent budgétaire (2% du PIB), forte croissance (4%), créations d’emplois et rattrapage salarial. |
La politique monétaire n’a pas été sans effet :
- Lorsque le taux de croissance > taux d’intérêt => économie stimulée (endettement, hausse prix des actifs)
- Lorsque le taux de croissance < taux d’intérêt => situation inversée
A l’heure actuelle, la zone euro ne peut revendiquer une mobilité totale du facteur travail ou l’existence d’une solidarité budgétaire (système de redistribution des prestations sociales). Le budget communautaire est très faible (1,1% du PIB) et les traités n’autorisent pas d’aides directes entre les Etats (no bail out).
Leurs propositions pour une solidarité européenne :
- Etablir un dispositif d’aide mutuelle (l’accord du 25 mai 2010 est un premier pas en la matière)
- Afficher des objectifs réalistes de réduction des déficits publics sans casser la reprise.
- Mettre sur pieds une supervision macroprudentielle
- Faire converger les économies par rapprochement des législations fiscales et sociales.
[i] Le Brésil a fixé un taux d’entrée des capitaux à 2 %
[ii] Les disparitions d’emplois dans l’industrie serait pour 25% du au phénomène de tertiarisation, 30% du aux gains de productivité, et 45% à la concurrence étrangère.
[iii] Sans transfert public, le revenu consommable américain aurait été inférieur de 9% à celui dont les ménages américains ont disposés en 2009
00:04 Publié dans Livres | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : économie, moscovici
10 juillet 2010
Après la démocratie - Emmanuel Todd
 C’est sur le blog de Malakine, recommandé par notre ami Belgo en 2007 déjà, que j’ai entendu parler d’Emmanuel Todd, anthropologue et essayiste français, défenseur d’un protectionnisme européen et auteur, malgré-lui, de la formule « la fracture sociale », devenu le thème de campagne de Chirac en 1995.
C’est sur le blog de Malakine, recommandé par notre ami Belgo en 2007 déjà, que j’ai entendu parler d’Emmanuel Todd, anthropologue et essayiste français, défenseur d’un protectionnisme européen et auteur, malgré-lui, de la formule « la fracture sociale », devenu le thème de campagne de Chirac en 1995.
Il s’est rendu célèbre pour ses ouvrages « prémonitoires » sur la fin de l’empire soviétique (La chute finale) ou les difficultés de l’hégémonie amériaine (Après l’empire) et sa défense sur modèle français d’intégration (Le destin des immigrés). En novembre 2008 il publie Après la démocratie, un essai d’analyse sur ce qu’il appelle « le moment Sarkozy ».
En introduction, il dénonce l’incompétence diplomatique et économique du Président de la République, ainsi l’exhibition de sa vie privée. Il voit dans l’élection de Sarkozy, le signe de la vaste crise idéologique contemporaine et de la montée en puissance des forces antidémocratiques.
Todd va alors analyser les défauts humains et sociétaux : le respect des forts et le mépris pour les faibles, le culte affiché de l’argent, la défense des inégalités, le narcissisme, le besoin d’agression et la désignation de boucs émissaires.
L’incohérence de la pensée du président correspondrait au vide idéologique et religieux de nos sociétés, la médiocrité intellectuelle renvoie à une crise profonde de l’éducation et de la démocratie, l’agressivité à la désignation de non-citoyens, l’amour de l’argent pose le problème plus général de l’acceptation aveugle du libre-échange et des inégalités qu’il génère et, enfin, l’instabilité affective trouve un écho dans l’évolution des valeurs familiales.
La mort des idéologies et la désaffection religieuse.
Todd explique que les valeurs religieuses structuraient en profondeur la société française et dessinaient une géographie politique. Or aujourd’hui on assiste à une érosion des croyances (8 % de Français se déclarent en 2007 pratiquants réguliers pour 37 % en 1948) et une décomposition de l’idéologie politique. Et si la bipolarisation droite/gauche semble résister, elle est faite d’une souplesse qui s’apparente à bien des trahisons : conversion de la gauche socialiste au libéralisme, renoncement à la charité et conversion au culte de l’argent pour la droite.
Le vide métaphysique guette l’individu en quête de sens, et si le bien-être et la sécurité ont un temps remplacé les valeurs supérieures, que se passe-t-il, se demande Todd, lorsque le niveau de vie dans la société de consommation baisse ou que la sécurité n’est plus assurée ? La crise s’accompagne d’un retour logique de l’irrationnel.
La stagnation éducative et le pessimisme culturel contemporain.
A partir des cas de Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, Todd met en évidence une baisse du niveau de diplôme des hommes politiques actuels. Ces élites, selon lui, se répartissent toutefois aujourd’hui entre des énarques conformistes et convaincus par le credo libéral et des individus dont le niveau de diplôme est plus faible, qui sont émancipés mais qui n’ont pas pour autant de programme économique ou idéologique solide.
Ce vide s’explique par la crise éducative : encore aujourd’hui entre 5 et 10 % d’illettrés en France, stagnation, depuis 1995, des résultats et du niveau, le nombre de sortants sans diplôme du système et le nombre de bacheliers se stabilisent.
Deux faits se dégagent : d’une part, on a un discours démobilisateur sur l’inertie éducative qui démoralise la société (cf. essais de Finkielkraut, de Michéa ou de Baverez) et, d’autre part, il y a indéniablement une « pause éducative » (après deux siècles de progrès).
Autour de l’idée de « déclin » s’opère une convergence de deux écoles de pensée dites « réactionnaires » : la pensée unique néolibérale qui parie sur la régulation miraculeuse du marché et le national-républicanisme qui regrette un passé idéalisé et parie sur les vertus de la réaction.
La crise de la démocratie.
Nos démocraties contemporaines sont marques par un mécontentement général à l’égard des gouvernants, un fort taux d’abstention électorale (crise du système représentatif) et une dérive vers la droite.
Todd reprend Guy Hermet dans L’hiver de la démocratie en 2007 : le système démocratique combine la gouvernance (entendu comme oligarchie pour Todd) qui est réservée à une élite qui décide des grandes orientations et travaille avec des acteurs privés ou cooptés, et le populisme qui agit par les élections et travaille avec les acteurs de la société civile.
Todd insiste sur le lien entre la donne éducative, démocratie (sens critique) et l’homogénéité éducative de la France. Le développement de l’enseignement du secondaire et son ouverture démocratique génèrent une stratification de la population entre instruits primaires, secondaires, supérieurs.
L’hétérogénéité va primer dans la société et l’élite va progressivement craindre de perdre sa distinction. Elle se referme sur elle-même et développe des stratégies pour conserver la séparation avec le peuple. Cela peut se traduire par un certain nombrilisme culturel ou plus certainement par une forme de séparatisme social et spatial.
Les diplômés du supérieur de plus en plus nombreux perdent leurs attaches politiques et religieuses. La mort des idéologies aboutit à un resserrement sur les intérêts propres et efface les communications entre les strates sociales. Dans les partis politiques, cela se traduit par une séparation entre le militantisme concret de base et le militantisme intellectuel mais narcissique. Sur ce dernier point, il cite La société des socialistes, une enquête sociologique du milieu de militance socialiste.
La question de l’égalité.
Todd reprend le lien entre éducation et démocratie mais montre que la correspondance est rarement effective entre la montée de l’une et l’avènement de l’autre, car il entre en jeu une autre donnée : la structure familiale.
La structure familiale joue un rôle dans le rapport des peuples à l’égalité. D’après ce que j’ai compris, la structure familiale est la base de l’analyse d’Emmanuel Tood et le fil conducteur de sa pensée.
Il étudie la structure familiale en Angleterre, en France, en Russie et en Allemagne mais nous ne reproduirons que ici que son analyse pour l’Angleterre et la France.
| Angleterre | France |
| Famille paysanne nucléaire et propension à l’individualisme social | Modèle familial nucléaire mais égalitaire |
| L’inégalité dans l’héritage est possible | L’héritage se répartit entre tous les enfants du foyer |
| = Altérité | = Homogénité |
L’hypothèse d’une ethnicisation possible de la démocratie.
Todd analyse qu’aux États-Unis, la présence de groupes marginalisés (Indiens et Noirs) aurait permis de former la cohésion du groupe des Blancs (les WASP). La démocratie américaine se serait construire sur le fondement du racisme : des « Blancs » égaux face à des esclaves inégaux.
L’auteur note qu’il en est de même pour l’Allemagne nazie et pour l’Angleterre victorienne. Mais pour lui, la France fait ici figure d’exception, même si l’altérité structure dès la Révolution (l’aristocrate) et que la lutte des classes va prendre la suite. Mais l’égalité reste une valeur capitale.
Or, d’après lui, avec la présidence Sarkozy, on observe un retour du discours du bouc émissaire (l’immigré, le jeune, le musulman). La mise en place d’une grille de lecture ethnique de la crise des banlieues de 2005 et une instrumentalisation de l’insécurité peuvent créer une cristallisation identitaire.
Le libre-échange contre la démocratie.
Todd s’attaque au dogme contemporain de la liberté de circulation des marchandises. La globalisation, encore plus avec l’irruption de la Chine dans le jeu économique, conduit à une baisse des salaires et du niveau de vie.
Or il constate que cette intuition n’est pas partagée par les intellectuels en France : l’économie est encore vue avec distance, voire avec mépris. L’aveuglement semble primer : face à la baisse des revenus, la réduction des sécurités et de la fonction publique et la montée des inégalités, le discours reste celui du libre échange au moins du côté des strates supérieures et dirigeantes.
En revanche, le corps électoral, parce qu’il est plus touché par le libre-échange, se positionne de plus en plus en faveur de mesures protectionnistes et perturbe le fonctionnement des instances démocratiques par ses refus réguliers manifestés par les urnes.
La classe politique est, pour sa part, peu sensible au protectionnisme : la gauche met en avant l’argument selon lequel les pays du Sud seraient très désavantagés par des mesures protectionnistes et la majorité des sympathisants du PS, issus de la fonction publique, est relativement protégée de la mondialisation. À droite, les PME sont plus sensibles aux avantages du protectionnisme, mais les grands chefs d’entreprise issus des grandes écoles croient aux vertus du libre-échange.
Possible retour de la lutte des classes.
Celle-ci avait disparu du discours de la gauche avec l’effacement du PC et la chute du taux de syndicalisation. Pourtant, l’analyse des votes des dernières élections montre que la stratification économique joue encore un rôle capital.
Les inégalités augmentent entre la fraction la plus riche et la plus pauvre, la baisse du niveau de vie et la prise de conscience d’un avenir économique moins favorable bouleversent les rapports sociaux. Les conditions seraient donc réunies pour un retour de l’affrontement socio-économique ou pour la désignation d’un bouc émissaire ethnique ou religieux.
La France serait plutôt en voie de préférer la première hypothèse (conflits sociaux réactivés, rééditions de Marx…) tant son attachement à l’égalité la détourne pour l’instant de la réaction raciste.
Deux pistes possibles d’évolution de la société.
Selon Todd, ce sont aujourd’hui les classes moyennes qui par leur hésitation vont dessiner l’avenir de la société. Il envisage dès lors deux possibilités
La République ethnique : la crise suscite une fuite vers l’irrationnel et la désignation d’un bouc émissaire, ethnique, religieux ou racial. Il remarque la montée de l’islamophobie chez les élites (chrétiens et laïcs).
La suppression du suffrage universel : l’heure est à la dépolitisation. Les gouvernants ayant de plus en plus de mal à se faire élire pour ensuite ne pas parvenir à gouverner, on pourrait, dès lors, être « lucide » et passer à un régime autoritaire qui seul permettrait d’agir sans blocages.
Todd n’élimine pas tout à fait cette deuxième hypothèse même si basculer dans un régime autoritaire lui parait peu envisageable en France. Toutefois il souligne que, dans un climat sécuritaire, des individus fragilisés sur un plan économique ou social peuvent s’en remettre à un contrôle politique ferme. Selon lui, le risque de la suppression du suffrage universel est ainsi plus fort que celui de la solution ethnique.
Le protectionnisme comme solution.
Il note qu’avant la globalisation il y avait une convergence entre l’espace économique, l’espace social et l’espace politique. Or, la mondialisation a introduit une rupture dans cette harmonie.
A défaut de pouvoir élargir l’espace politique au monde (idée de démocratie mondiale), il préconise de réduire le champ économique en réintroduisant le rôle de l’Europe. Cette dernière doit opter pour des mesures protectionnistes.
Mais pour cela, il faut d’une part que l’Europe soit le vrai pari des gouvernants et non leur alibi, et d’autre part, il faudra surmonter le blocage allemand, dont le modèle de croissance économique s’inscrit dans la cadre de la mondialisation (jouer sur l’exportation et faire pression sur les salaires internes).
Dans le contexte actuel de crise de l’euro et de politiques de rigueur généralisée, inspirée l’Allemagne, puissance économique dominante au sein du l’UE, ou encore du refus d’une taxe carbone aux frontières, on voit bien que l’Europe ne s’oriente pas dans cette voie.
*
J'avoue que je ne m'attendais pas trop à ce type d'analyse quand j'ai acheté le livre. Je croyais au départ, que l'auteur y dessinnait ce que pourrait être le régime d'une post-démocratie. Mais je ne connaissais alors rien ou presque de l'auteur en question.
J'ai beaucoup aimé l'ouvrage, très bien construit parce que progressif, même si le ton parfois un peu violent vis à vis de quelques politiques surprend. Ton justifié par l'auteur par la violence symbolique même des responsables politiques.
Quand l'ouvrage est sorti, le monde était au bord du précipice avec la quasi-faillite du système financier international (risque systémique) et donc propice à un changement de paragdime, tout au moins à une remise en cause de certains postulats économiques et politiques, jusqu'ici "dominants".
Or deux ans après, malgré certains changements, on semble revenir aux discours et aux pratiques de l'avant-crise, comme si rien n'était arrivé.
23:35 Publié dans Livres | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : emmanuel todd
25 mai 2010
L'étranger
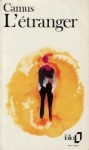 Depuis quelques temps déjà, je tarde à m'endormir et les nuits sont courtes. L'autre soir, incapable de calmer mon esprit, j'ai pris un des livres entreposés sur ma table de chevet : L'Etranger d'Albert Camus, retrouvé il y a peu dans une armoire lors d'un rangement.
Depuis quelques temps déjà, je tarde à m'endormir et les nuits sont courtes. L'autre soir, incapable de calmer mon esprit, j'ai pris un des livres entreposés sur ma table de chevet : L'Etranger d'Albert Camus, retrouvé il y a peu dans une armoire lors d'un rangement.
Je dois admettre que je connais peu les œuvres de Camus. J'avais survolé un de ses livres, Le premier homme, en cours de français en classe de Première sans avoir été convaincu. Mais avec le débat lancé il y a quelques mois sur le transfert de son corps au Panthéon a avivé ma curiosité sur l'œuvre du bonhomme.
L'histoire se déroule en Algérie. Monsieur Meursault vient d'apprendre le décès de sa mère, placée en asile il y a quelques années. De l'enterrement de sa mère jusqu'à son exécution en place publique pour homicide, Meursault nous raconte alors son quotidien au travail, dans les rues d'Alger, à la plage, au tribunal, en prison.
Le rythme du récit est vif, rapide parce que le narrateur est minimaliste dans ses descriptions des événements, les lieux, des gens, des propos échangés. On est frappé par l'indifférence, presque apathique, du personnage au regard des situations qu'il rencontre (enterrement, procès) et des personnes qu'il croise (ses voisins, sa fiancée). Une indifférence qui révèle une certaine naïveté du personnage et le rend étranger à cette terre, ses semblables, lui-même. C'est aussi cette indifférence qui le fait condamner à mort.
Entre les lignes, une réflexion sur la norme sociale, la vie, la mort, la liberté, le destin. L'absurdité de chacun de ces termes. Une œuvre que j'ai pris plaisir à lire, peut être un peu trop rapidement.
01:05 Publié dans Livres | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : albert camus
08 avril 2009
The Plot Against America
En 2006 paraissait La complot contre l’Amérique de l’écrivain américain Philip Roth. La première de couverture du livre – un timbre et une croix gammée – et surtout le scénario – l’arrivée au pouvoir en 1940 de Charles Lindbergh sur la base d’un programme anti-guerre et antisémite – avait attirée mon attention. Mais je n’ai acheté le livre que l’été dernier, pour le prêter de suite à un amis, et ne l’ai lu qu’entre novembre et décembre.
Que ce serait-il passé si Charles Lindbergh, connu pour ses exploits aéronautiques comme pour ses opinions antisémites, avait accédé à la Maison Blanche alors que l’Europe puis le Monde s’engageait dans une nouvelle guerre mondiale ? Philip Roth, qui était âgé de sept ans en 1940, opte pour le récit partiellement autobiographique pour imaginer puis décrire le vécu et le ressentie de sa famille, de confession juive, face aux évènements.
Dans les premiers chapitres, le décor familial est planté. La famille Roth, issue de la petite classe moyenne, vie modestement dans les quartiers juifs de New York (?). Le père qui travaille dans les assurances est un supporter du grand Roosevelt. La mère, femme au foyer, est une femme discrète. Philip est alors un enfant effacé, collectionnant les timbres, entre le grand frère, un artiste en herbe qui sait attirer l’attention, et Calvin, le cousin orphelin, quasiment jeune adulte, que ses parents ont recueillit.
Lorsque Lindbergh fait ses premières déclarations, le sujet anime le débat de la communauté juive mais n’inquiète pas outre mesure. Or l’aviateur, fort de son statut de héros national, voit sa popularité augmenter en jouant sur la fibre isolationniste des Américains. Il finit par être investie, de façon inattendue, lors des primaires du Parti Républicain, pour affronter Roosevelt aux élections présidentielles de 1940. Accusant ce dernier de vouloir conduire les Etats-Unis dans une guerre qui n’est pas la leur, sous l’influence de « lobbies étrangers » (anglais, juifs et communistes), Lindbergh finit par être rallié par un rabbin d'influence, invalidant les attaques sur son supposé antisémitisme. Il finit par battre Roosevelt en promettant aux Américains de signer un traité de non agression avec l’Allemagne nazie.
La petite vie tranquille de la famille Roth est alors rompue. Calvin décide de s’engager dans les forces canadiennes pour aller combattre le nazisme en Europe, il en reviendra mutilé. La famille Roth subie les premières discriminations anti-juives lors d’un voyage à Washington. La belle sœur vante aux Roth les mérites du Président Lindbergh et se rapproche du Rabbin qui soutient ce dernier. Le frère de Philip participe à une opération lancée par le gouvernement américain visant à placer les enfants juifs, sur la base du volontariat et pour quelques mois, dans une famille américaine classique. Du haut de ses 10 ans, l’enfant en ressort supporter convaincu de Lindbergh. La cohésion familiale en prend un coup.
Je n’en dirai pas plus sur l'histoire pour ne pas gâcher le plaisir de découvrir le livre.
Tout au long du roman, Roth alterne entre le regard impuissant mais saisissant de l’enfant sur le désarroi et la panique de ses parents face aux évènements et la vie et les préoccupations d’un petit garçon, indirectement concerné par les affaires de ce monde, mais partiellement conscient des dangers de celui-ci. Alors qu’on aurait pu imaginer, sur la base de l’expérience nazie, que la communauté juive américaine soit victimes d’actes de violence physique, c’est en fait la pression psychologique qui est mis en avant, par l’état presque paranoïaque des parents Roth. Alors que sous le IIIème Reich, la politique antisémite visait à concentrer les juifs à l'intérieur des camps, à l'abri des regards, la politique de Lindbergh consiste au contraire à isoler les juifs américains sur tout le territoire américain, parmis les Américains.
La fin de l’histoire m’a déçue car elle vient un peu subitement. On a le sentiment que les derniers chapitres ont été bâclés, comme si l’auteur n’arrivait pas à s’en sortir. La tension politique que l’on ressent tout au long de la première moitié du roman débouche subitement sur de la violence ouverte qui fait tout basculer. C’est alors qu’est révélée la nature du complot contre l’Amérique. Et alors on se dit que ce qui fondait l'histoire est largement impropable.
23:26 Publié dans Livres | Lien permanent | Commentaires (1)
22 octobre 2008
El pintor de batallas
 Lors de mon séjour à Barcelone l’an passé, à l’occasion d’une fête catalane - dont j’ai oublié le nom - où la tradition veut qu’on offre une rose aux femmes et un livre aux hommes, mon oncle m’avait offert El Pintor de Batallas (le peintre des batailles) d’Arturo Pérez-Reverte.
Lors de mon séjour à Barcelone l’an passé, à l’occasion d’une fête catalane - dont j’ai oublié le nom - où la tradition veut qu’on offre une rose aux femmes et un livre aux hommes, mon oncle m’avait offert El Pintor de Batallas (le peintre des batailles) d’Arturo Pérez-Reverte.
L’auteur est membre de la Real Academia Española, l’équivalent - je suppose - de l’Académie française. Il est notamment l’auteur de la série Capitan Alatriste récemment porté au cinéma avec Viggo Mortensen dans le rôle du personnage principal (j’avoue ne pas avoir vu le film mais il a l’air bien). Enfin, dans l'ordre de l'anecdote, l'auteur a signé un Manifeste pour une Langue Commune, en vue de défendre le castillan dans certaines communautés autonomes (le super-régions espagnoles). Il s'explique là.
L’histoire tourne autour de Faulques, un ancien photographe de guerre, retiré dans une tour d’un petit village face à la Méditerranée et qui entreprend la peinture d’une grande bataille intemporelle. Une fresque largement inspirée des guerres qu’il a couvertes avec sa compagne décédée des années auparavant.
Mais un jour il reçoit la visite d’un homme tout droit surgit de son passé de photographe venu honorer une dette mortelle. Le chasseur et la proie vont alors cohabiter jusqu’à l’achèvement de l’œuvre del Pintor de Batallas, chacun exprimant peu ou prou ses motivations et son parcours depuis leur première rencontre.
Habilement écrit, le récit alterne prodigieusement entre une série de flash backs du personnage principal, torturé par les souvenirs de sa compagne qu’il a vu mourir sous ses yeux, et les échanges, parfois aux accents de monologues, entre le peintre et l’étranger. Cette articulation permet à l’auteur d’aborder des thèmes aussi variés qu’imbriqués : l’art, la science, la guerre, l’amour, la lucidité, la solitude...
En fond, un questionnement sur la responsabilité que peut avoir un étrange spectateur comme l’est un photographe de guerre dans la vie des gens qu’il révèle à la face du monde. Une sorte d’effet papillon en somme. Et enfin cette fresque, bien décrite dans plusieurs passages du livre, dont je comprends après coup toute la symbolique qu’elle comporte : les deux personnages se retrouvent à la fois créateurs et membres d’un monde à l’agonie. Un champ de bataille, point de départ de leur rencontre, point d’arrivée de leur histoire respective.
Au final, j’ai mis un certain temps à lire ce livre. Ca faisait quelques temps que je n’avais pas lu l’espagnol, et la richesse du vocabulaire et de la description m’a longtemps rebuté. Un livre, on y est ou on n’y est pas. Par ailleurs le thème, vous l’aurez compris, n’est pas très joyeux. Quant au personnage central, torturé par ses souvenirs de guerre et refermé sur lui-même, on éprouve tout juste de l'empathie. Physiquement malade, il cherche dans son œuvre un sens à sa vie et un point de salut. Mais il est déjà mort…
00:09 Publié dans Livres | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : barcelone



