12 décembre 2012
Hollande : comparaison n’est pas raison.
Les média et politiques français adorent faire des comparaisons entre la France et ses partenaires étrangers, européens en particuliers. Et ce pseudo exercice de brainstorming se conclue généralement par une apologie d’un modèle extérieur, qui change au fil des années (Etats-Unis, Grande-Bretagne, Espagne, Allemagne) et qu’il conviendrait de copier en intégralité, et par contrecoup, par une auto-flagellation nationale.
Depuis son élection à la présidence de la République en mai dernier, François Hollande est quotidiennement comparé à des chefs d’Etat ou de gouvernement de sensibilité progressiste, socialiste ou social-démocrate, exerçant le pouvoir ou l’ayant exercé de nombreuses années. Ceux qui osent ce parallèle appellent le chef de l’Etat à suivre tel modèle et à fuir celui-ci, sous peine de laisser le pays s’enfoncer un peu plus dans le déclin : « moi ou le chaos » en somme.
Mélenchon l’a comparé à Papandréou, l’ancien premier ministre grec, pour lui reprocher de capituler face à l’ « Europe austéritaire ». Larrouturou et son collectif Roosevelt 2012 appelle à s’inspirer du père du New Deal pour sortir de la crise. Fressoz, journaliste au Monde, le met en garde contre le syndrome Zapatero qui a privilégié les réformes sociétales aux réformes économiques. Avant l’annonce du pacte de compétitivité, Schröder était l’exemple à suivre. Maintenant c’est Bill Clinton ou Mario Monti.
Evidemment les critiques adressées au nouvel exécutif ne sont pas sans fondements. Oui, Hollande aurait du aller plus loin dans le bras de fer avec Merkel, même s’il a obtenu des avancées sur la croissance et la taxe tobin. Oui, il est urgent de réformer le système bancaire et financier. Oui, la France souffre d’un problème de compétitivité mais Hollande a toujours dit qu’il fallait centrer nos efforts sur la qualité, la recherche, l’innovation. Oui, les réformes sociétales (mariage pour tous, vote des étrangers en situation régulière aux municipales) sont loin d’être prioritaires alors que l’économie stagne voir recule.
Mais quand on regarde à l’étranger, autant le faire le plus objectivement possible.
- On passe souvent sous silence que Clinton a relevé le salaire minimum et le niveau d’imposition durant son premier mandat, comme le fait que c’est sous sa présidence (mais majorité républicaine) qu’a été abrogé le Glass-Steagal Act (qui encadrait les activités bancaires). Enfin ses mandats coïncident avec la reprise économique liée aux NTIC.
- Plombée par les années Berlusconi, l’Italie avait grandement besoin d’un homme sérieux à sa tête. Européen convaincu, économiste et ancien commissaire européen à la concurrence, Mario Monti a donné un gage de sérieux et de crédibilité auprès des marchés. Mais il a gouverné sans aucune légitimité politique, avec une majorité parlementaire bricolée et donc fragile. Malgré un rythme de réformes très soutenues, l’Italie s’enfonce dans la récession et les primes de risques sur sa dette ont jouées au yoyo tout au long de l’année.
- Zapatero s’est beaucoup illustré sur les réformes de sociétés : mariage homosexuel, droit à l’adoption pour les couples homosexuels, la parité, la lutte contre les violences conjugales, loi sur la mémoire historique, réforme de l’avortement etc. La plus part de ces réformes ont été menées au moment où l’économie espagnole marchait à plein régime. Le bilan économique de son premier mandat est plutôt honorable.
- Le dynamisme allemand tient plus de son réseaux de PME (plus nombreuses et plus exportatrices qu’en France), de son positionnement vers le haut de gamme, qu’à une modération salariale, certes bien réelle, mais d’une portée limitée face aux pays émergents. Derrière le « miracle » allemand, se cache des réalités sociales très difficiles : quatre millions de personnes gagnent moins de 7 € bruts de l’heure, 11 % des travailleurs avec des CDI sont des travailleurs pauvres, 761 000 seniors complètent aujourd’hui leur pension avec un mini-job etc.
Il revient à Hollande et à notre pays de créer son propre modèle, son propre succès. S’inspirer sur certains points de nos voisins, c’est une chose, nous vendre des mirages pour engraisser les mêmes, ça va un moment. L’efficacité de la méthode Hollande, négociation sociale/ rapports d’études/ commissions, très sociale-démocrate, se vérifiera à l’usure. La difficulté tient en ce qu’elle exige du temps alors que les attentes et les difficultés sont elles très urgentes et présentes.
22:37 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hollande, mélenchon, zapatero, social-démocratie, larrouturou
30 juin 2012
Hommage à Olivier Ferrand

J’apprends à l’instant la mort d’Olivier Ferrand, jeune député socialiste de la huitième circonscription des Bouches-du-Rhône et fondateur du centre de réflexion social-démocrate Terra Nova, emporté ce matin par une crise cardiaque. Il avait à peine 42 ans. C’est un vrai choc. Je suis même écœuré par cette disparition.
Comme beaucoup de monde, je l’ai découvert via la fondation Terra Nova qu’il a crée en 2008 et qu’il n’a cessé d’animer (par ses contributions d’idées et la construction d’un véritable réseau) et de porter depuis, notamment dans les média (tribunes, émissions télévisuelles ou radiophoniques).
Il ne ménageait pas sa peine, comme le prouve ses nombreux déplacements en 2008-2009, dans les fédérations socialistes, dans les réunions de courants (plutôt « soc-dem ») etc… pour y promouvoir les primaires, dont il est un des principaux instigateurs en France. Le succès de Terra Nova aujourd’hui lui revient largement.
Lorsque ce think tank a vu le jour en 2008, j’étais satisfait de voir émerger un lieu de pensée, un temps déconnecté des stratégies individuelles, capable de renouveler la matrice intellectuelle du PS. J’avais toutefois exprimé quelques réserves sur sa pérennité et sa capacité à diffuser les idées. L'action d'Olivier Ferrand m’aura donné tort.
14:27 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gauche, ps, primaires, social-démocratie
09 juillet 2011
Le nouveau candidat des socialistes espagnols.
 Cet après midi, le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol (PSOE) a officiellement investi Alfredo Perez Rubalcaba, actuel Ministre de l’Intérieur et Premier Vice-Président du Gouvernement Zapatero, comme le candidat tête de liste des socialistes pour les élections législatives de l’an prochain.
Cet après midi, le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol (PSOE) a officiellement investi Alfredo Perez Rubalcaba, actuel Ministre de l’Intérieur et Premier Vice-Président du Gouvernement Zapatero, comme le candidat tête de liste des socialistes pour les élections législatives de l’an prochain.
En avril dernier, José Luis Rodrigues Zapatero avait annoncé qu’il ne souhaitait pas briguer un troisième mandat. Ce faisant il espérait pouvoir empêcher, ou tout au moins limiter, une lourde défaite aux élections municipales et dans quelques régions. Il n’en fut rien.
Le prochain candidat tête de liste des socialistes espagnols devait être désigné par la voie d’une primaire interne, comme cela avait été le cas en 1998 pour les législatives de 2000. Rubalcaba et Carme Chacon, la jeune ministre de la Défense, étaient vu comme les favoris.
Mais au nom de l’unité du parti, Chacon a renoncé à se présenter à la primaire. Et le seuil de parrainages, excessivement élevé, n’a pas permis à d’autres candidats de se confronter à Rubalcaba, seul candidat déclaré. La primaire a donc été annulée, et Rubalcaba officiellement investi.
Son discours d’investiture est l’occasion d’en savoir plus sur les grandes lignes du projet politique de cet ancien coureur de fond, débateur craint et réputé, homme sobre mais respecté, déjà ministre dans les gouvernements de Felipe Gonzalez et pilier de ceux de Zapatero.
Ses grandes priorités sont donc l’emploi, la santé et la compétitivité de l’économie, l’égalité des chances et l’approfondissement de la démocratie. Il réaffirme le droit au volontarisme politique face aux marchés. Il prévient toutefois qu’il ne s’engagera pas sur des promesses qu’il sait ne pas pouvoir tenir.
Il souhaite une contribution sur les bénéfices des banques au profit d’un fond pour l’emploi et la reconversion de l’économie (formation, développement durable, services à la personne). Il s’engage à rétablir l’impôt sur le patrimoine, supprimé en 2007, en le ciblant sur les très hauts revenus. Il promet une réforme de la loi électorale en s’inspirant du modèle allemand. Il veut défendre la santé publique.
En réhabilitant l’impôt (sur le patrimoine, sur le bénéfice des banques ou les transactions financières) et la redistribution (éducation, formation, santé, famille), Rubalcaba revient aux fondamentaux sociaux-démocrates. Et ses engagements sur la loi électorale ou les comportements politiques sont une manière de répondre aux revendications des Indignés.
Il reste que la position de Rubalcaba n’est pas des plus aisées. Les socialistes sont largement devancés par la droite, dans les intentions de vote à moins d’un an des élections. Il est politiquement lié au bilan du gouvernement Zapatero, y compris les mesures liées au tournant de la rigueur adoptées en mai 2010, et le revendique.
Toute la difficulté va être pour lui de marquer ses distances avec Zapatero tout en le soutenant jusqu’au bout, et de dessiner une sorte d’alternative tout en gardant à l’esprit l’étroitesse des marges de manœuvres et la présence de menaces financières réelles.
23:55 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : espagne, social-démocratie, psoe, zapatero, felipe gonzalez, rubalcaba, primaires
08 avril 2011
Mémoire vivante - Michel Rocard
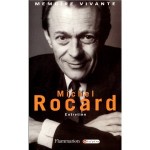 La note de lecture qui suit remonte à octobre 2006. Le Parti Socialiste organisait ses primaires pour désigner son candidat à la magistrature suprême. Sans être militant, je soutenais déjà Dominique Strauss-Kahn et les idées social-démocrates, autrefois incarné par Michel Rocard et Jacques Delors.
La note de lecture qui suit remonte à octobre 2006. Le Parti Socialiste organisait ses primaires pour désigner son candidat à la magistrature suprême. Sans être militant, je soutenais déjà Dominique Strauss-Kahn et les idées social-démocrates, autrefois incarné par Michel Rocard et Jacques Delors.
J'ai fait le choix de ne pas retoucher mon texte même si, sans avoir relu le livre, j'aurai certainement une autre façon de voir et présenter les choses aujour'hui. J'ai trouvé intéressant de pouvoir relire les enseignements que j'avais tiré des propos de Rocard, à l'aune de la crise internationale et de la présidence Sarkozy surtout. Si j'ai pris d'avantage de distances avec le personnage Rocard et quelques unes de ses analyses, je reste fidèle à ses idées.
A noter que Michel Rocard est revenu sur son parcours personnel et politique dans deux ouvrages: Si la gauche savait (2005), Si ça vous amuse. Chroniques des mes faits et méfaits (2010).
*
Ce livre d'entretien avec Michel Rocard date de 2001. Bien que l’homme ait surtout marqué l’actualité politique des années quatre-vingt, donc une période que je n’ai pas connu du fait de mon jeune âge, j’éprouve à son égard une grande admiration mêlé d’un immense respect. Cet homme que les média d’aujourd’hui ont un peu oublié fait pourtant parti de ceux qui ont marqué l’histoire de la gauche française ces 40 dernières années.
Certaines mauvaises langues ne voient en lui qu’un perdant sous prétexte qu’il ne serait pas devenu président de la République, poste qu’il aurait convoité pendant tant d’années alors que « tout » (la popularité dans les sondages ; la compétence) le prédisposé à ce destin. D’autres voient en lui une occasion manqué, constituant un « certain regret ». Le regret de n’avoir pu rénover le socialisme français (notamment faire émerger une social-démocratie française assumée), le regret de n’avoir pu inculquer une nouvelle méthode de gouvernement à une classe politique de plus en plus coupé des réalités, le regret de n’avoir pu rassembler les français pour moderniser notre société.
Et si certains éprouvent ce regret, c’est bien que l’état actuel des choses (la décrépitude du Parti Socialiste français ; la crise socio-politique du CPE, le non au T.C.E…) ne nous poussent pas à l’optimisme. Le livre ne raconte pas seulement le vécu d'un des plus atypiques hommes politiques français de ces trente dernières années, mais il expose nombre de ses pensées et réflexions. Et on comprend alors toute la modernité de son engagements, de son raisonnement, de sa méthode.
Une première partie du livre est consacré à sa jeunesse, à ses parents, à ses études… On comprends de suite que c’est un certain niveau. Son père (qui a contribué à l’élaboration de la bombe atomique française), son grand père et son arrière grand père ont tous les 3 fait Polytechnique… d’où ses capacités en mathématiques qui l’aideront à étudier l’économie. Lui-même a fait Sciences po puis l’ENA puis l’Inspection des finances (grand corps d’Etat).Il raconte sa relation avec son père (qui ne lui pardonne pas d’avoir délaissé les sciences exactes pour sciences po) et sa mère (qui lui inculque les principes protestants). Il est fait mention des événements (la guerre, l’occupation), des rencontres (un ouvrier, un prêtre protestant) qui l’ont amené à tenter la voie politique. A une époque où le communisme est très en vogue, surtout chez les jeunes, Michel Rocard préfère s’en tenir à l’écart (il comprendra très vite le sectarisme des militants PC) sans pour autant adhérer à la SFIO (ancien PS) vieillissante et empêtrée dans les guerres de décolonisations.
Dans une autre partie, l'ancien Premier Ministre revient sur ses activités militantes et politiques à l'occasion de la guerre d'Algérie. Effectuant son service militaire en Algérie il contribuera par l'intermédiaire d'un rapport à informer l'opinion publique sur les pratiques de la torture par l'armée française. Anti-colonialiste dans l'âme, il se définit comme un militant des droits de l'homme (et donc socialiste par logique…sa logique) et non l'inverse.
Sont également abordés son choix d'intégrer l'Inspection des finances (un des grands corps d'État) à la sortie de l'ENA, et les informations et savoirs faire qu'il en retire en terme de culture économique et fiscale ("connaissance du réel", ex: impact d'une nouvelle mesure fiscale auprès de commerçants).
Mai 68 est un autre des grands événements où Michel Rocard s'est illustré. Il nous explique alors la création du PSU (parti socialiste unifié, en référence à l'œuvre de Jaurès lorsqu'il fonda le PSU-SFIO), et le rôle de celui-ci dans l'anticipation et l'accompagnement des mouvements estudiantins et ouvriers. Dans un souci de respect de l'ordre public, soucieux d'éviter les affrontements entre manifestants et CRS, il ira jusqu'à annuler des manifestations. Il revient sur ses relations avec Daniel Cohn-Bendit, avec Pierre Mendès-France (à l'occasion de la grande réunion de Charléty) et bien sur, François Mitterrand (jugé "hors jeux" par rapport aux événements).
Au travers de deux autres chapitres, il relate son adhésion au PS dirigé alors par Mitterrand, et son expérience gouvernementale après la victoire de la gauche en 1981. Il revient sur ses divergences avec François Mitterrand tant en termes de culture politique (le fameux clivage "première/deuxième gauche") que de choix stratégiques à adopter. Par exemple s'il adhère à l'union de la gauche avec les communistes, il conteste en parties le programme commun de gouvernement (dont les nationalisations à 100%) que sous-tend l'union PS-PC. Il regrette vivement la surenchère idéologique adopté par le PS, le manque de "parler vrai" des politiques face aux citoyens, que le PS payera dès 1983…
Il nous fait part de son expérience gouvernementale. Qu'il soit au ministère du Plan, de l'agriculture ou à Matignon, il applique la méthode Rocard que l'on pourrait résumer par le triptyque " déminer- dialoguer- solutionner". En rentrant dans le détail, il nous explique comment ministre de l'agriculture il a contribué avec le conseil des ministres de l'agriculture au niveau européen, à réformer la PAC (entre autres). Sur son passage à Matignon, il nous explique en large et en travers comment il a obtenu les accords de paix de Nouméa, comment est né l'idée de RMI et comment il l'a négociée et mise en application très rapidement (je dis "il" mais bien sur l'entreprise est collective). Il aborde la question de la mise en place de la CSG (contribution sociale généralisée) et de la réforme de l'assurance maladie (négociation entamée avec lui, rompue à l'arrivée d'Edith Cresson). Autres réformes à son actif, la "réforme" de la langue française (sujet en apparence anodin mais bien complexe), le sauvetage de Renault (fusion avec Volvo), le changement de statut des PTT (devenu distinctement La Poste et France Télécom), un début de réforme de la justice. S'il regrette de ne pas avoir fait la baisse du temps de travail, il s'enorgueillit d'avoir entamé la réforme lente et discrète de l'assurance maladie et du système de retraites; regrettant qu'Edith Cresson en ait interrompue la négociation ou bien la méthode des Premiers Ministres Balladur et Juppé par rapport aux retraites.
Enfin les deux derniers chapitres abordent l'après Matignon, à savoir son bref passage à la direction du PS et son engagement européen en tant que député européen auprès de Yasser Arafat notamment.
Tout au long de l'entretient, Michel Rocard développe sa réflexion sur bien des sujets. Le rôle et les responsabilités de l'élu, les affaires, la mondialisation et l'évolution du capitalisme, les relations Nord-Sud, l'Europe politique sont tour à tour abordées.
Ce que j'ai retenu de Michel Rocard en termes de mode de gouvernement :
- Ne pas penser obligatoire en terme de clivages… idée que l'on retrouve dans son discours de politique générale devant l'Assemblée Nationale en 1988. "Je rêve d'une politique où l'on soit attentif à ce qui est dit plutôt qu'à qui le dit". D'ailleurs on ne peut être que frappé de voir, tout au long de l'entretien, Michel Rocard rendre hommage à divers hommes politiques en particulier ceux avec qui il n'est pas d'accord (Juppé, Chevènement etc.).
- Le rôle de l'élu n'est pas d'inventer, il n'en a ni le temps ni les facultés (au sens de formation), mais de sélectionner/arbitrer les mesures proposées par les techniciens de l'économie et du social. On serait tenter d'y voir une justification de l'Énarchie et de la technocratie confisquant le pouvoir au élus, moi j'y vois plutôt une légitimation de l'élu professionnel. Personnellement j'aime bien comparer un élu à un artiste. L'élu est essentiellement devenu un interprète… mais rien ne l'interdit de composer !
- Une volonté ferme de dialogue, de concertation longue et continue entre les acteurs concernés, les plus à même à apporter une solution aux problèmes/phénomènes qu'ils vivent au quotidien. En ce sens, la décentralisation poussée est préférée au jacobinisme et son centralisme.
- Tant qu'on préférera le spectaculaire au discret, l'immédiat au durable, le symbolique au concret, la loi dictée par l'État au contrat négocié parles acteurs sociaux… alors aucune réforme n'est envisageable en France. Et une réforme sera d'autant plus accepté que les coûts seront partagé par toute la société.
Au regard de cette éthique, au regard de cette rigueur d'esprit… est-il possible de dire si aujourd'hui les prétendants à la présidence de la République soient acquis à ce mode de gouvernance ?
07:00 Publié dans Livres | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rocard, dsk, social-démocratie, ps, pcf, mitterrand
16 janvier 2011
Les "grands récits"
J’ai envie de développer un peu plus cette notion de « grands récits » avancée sur le blog de Catherine, à l’occasion d’une discussion sur la stratégie de Mélenchon. Car le concept va en réalité au delà de la seule sphère politique, entendue ici comme les institutions publiques et la compétition pour l’exercice du pouvoir.
De mon point de vue l’Homme se caractérise par sa capacité à donner du sens aux choses (ses propres actions, celles de ses semblables, son environnement) et à se projeter dans un cadre temporel. Autre manière de dire que l’Homme est un être capable d’introspection.
Mais c’est aussi un animal social car il vit avec et par ses semblables. Les logiques de reproduction et de survie dans un environnement hostile sont les deux formes indépassables de dépendance sociale. De cela découle une nécessaire division des tâches sociales et la faculté et nécessité de communiquer. L’introspection passe au niveau collectif et s’enrichie d’une logique de transmission.
A partir du moment où nous avons développé la parole, nous avons élaboré les premiers grands récits. Ces grands mythes venaient expliquer nos origines et tout ce qui est encore inexplicable, et au final exorciser nos craintes de l’inconnue. Au fur et à mesure que les communautés humaines se sont complexifiées, les récits ont normalisés les coutumes sociales et légitimés les sanctions de leur inobservation.
Toutes religions et croyances reposent sur un grand récit. Leur institutionnalisation est le fruit des transformations successives des communautés : la sédentarisation a favorisé la constitution des lieux de cultes en faveur des divinités localisées à formes humaines ; l’écriture a facilité la transmission de la mémoire collective (l’histoire orale se précise par l’écrite) et l’uniformisation de la doctrine religieuse (écriture des Livres des grandes religions) ; et la centralisation du pouvoir politique.
La question du pouvoir est présente dans toute société, elle précise le processus de décision collective et son effectivité. Les institutions politiques et religieuses en Occident (au moins) vont se construire en parallèle : le pouvoir royal se donne une nouvelle légitimité (l’oint de Dieu) et en retour les institutions religieuses étendent leur champ d’influence, voir obtiennent une situation de monopole spirituel.
Avec les révolutions américaines et françaises, on sort petit à petit du grand récit royal et du sacré. La philosophie des Lumières, le culte de la Raison et l’avancée des sciences contribue à la sortie de la religion. On glisse vers la souveraineté nationale, qui légitime le nouveau régime (la République) tout en s’inspirant des vieux récits pour le consolider : cultes mémoriels, cérémonies républicaines, hymne national, drapeau etc.
Tout au long du XIXème siècle, les républicains et les monarchistes développent chacun un grand récit pour convaincre et se rallier la masse du peuple encore peu alphabétisé, dans un contexte d’extension du suffrage universel. La consolidation du régime républicain et l’arrivée de la question sociale feront émerger les grands récits socialistes. La Première guerre mondiale et l’incapacité des démocraties libérales à enrayer la crise des années 30 donnent de la voix aux tenants des grands récits totalisants fascistes et soviétiques.
Le gaullisme représente aussi une forme de grand récit, qui a permis d’une part, d’incarner la voix de la France résistante et exorciser la défaite de 1940 et la Collaboration ; et d’autre part justifier la Vème République avec un exécutif fort, un parlementarisme rationalisé, et conceptualiser un positionnement politique qui se veut au-delà des grandes idéologies (ou modèles de société) en France comme à l’étranger.
On devine également un autre grand récit pour accompagner la conquête du pouvoir par la gauche (« la rupture avec la capitalisme pour changer la vie avec l’union de la gauche ») ou expliquer les aléas liés à son exercice. Le fameux tournant de la rigueur a donné lieu à diverses interprétations.
Certains disent que les socialistes, sous l'influence des sociaux-libéraux et des acteurs financiers, ont renoncés à leur projet de rupture avec le capitalisme de 1981. Ils parlent de renoncement politique à l’origine, selon eux, du désenchantement du peuple de gauche. On compte parmi les tenants de cette thèse les amis de Chevènement (voir son dernier livre) et les amis de Mélenchon. Les trotskystes font plus simple encore : les socialistes sont par nature des sociaux-traites et réformer le capitalisme est une impasse.
Les socialistes réformistes ou sociaux-démocrates (revendiqués ou non) expliquent que le tournant de la rigueur symbolise la conversion des socialistes au réalisme et aux responsabilités qu'incombe le pouvoir. Mais comme certains ont eu du mal à assumer le changement de cap, on a parlé de parenthèse. Comme disait l’autre, on ne sort de l’ambigüité qu’à son détriment. C’est à partir de cette époque qu’on a clairement insisté sur le grand récit européen comme récit de substitution.
L’extension et la diversification des média de masse d’une part, et l’individualisation des rapports et besoins sociaux d’autre part, a changé les règles de communication politique classique. A la trilogie classique « reconnaissance d’un problème/ analyse/ préconisation d’une solution », on a substitué la suivante « capter l’attention/ stimuler le désir de changement/ emporter la conviction par l’utilisation d’arguments raisonnés », doublé d’une mise en scène croissante du personnel politique.
Mais le développement du storytelling, dernier avatar de la communication politique professionnelle, laisse apparaitre plus une transformation des « grands récits » que leur disparition. Les « grands récits » n’ont pas vocation à raconter des histoires aux pauvres crédules que nous serions, mais à expliciter notre histoire présente et commune à tous les individus de ce collectif qu’est la société. Il n’y a pas de vérités ou de mensonges mais seulement un rapport intellectualisé et émotif aux évolutions du grand monde, capable de fédérer une majorité.
C’est la raison d’être supérieure du politique : faire société, rassembler et utiliser les synergies individuelles pour conduire autant faire ce peu le changement incessant du monde. Or aujourd’hui les politiques font fasse à plusieurs défis :
- Les avancées scientifiques ne cessent de réduire le champ de l’inconnu et de l’inexplicable jusqu’ici mystifié (le désenchantement du monde) ;
- Les grands systèmes de pensée ne sont plus opérants dans la durée et dans les cas particuliers (la pensée complexe) ;
- L’économisme et la quantophrénie sont les nouvelles vaches sacrées
- Le consumérisme et la marchandisation du monde réduisent le lien social à une forme de compétition permanente..
Il y a d'autres choses encore certainement...
Ceux qui croient au récit du renoncement et de la trahison se racontent des bobards et se condamnent, s'ils reviennent aux responsabilités, au reniement le plus complet. Les vieux récits ne sont rien d’autres que des refuges.
Ma famille politique – le socialisme démocratique – a renoncé à proposer un grand récit fédérateur. Le récit européen est un substitut insuffisant dès lors que rien n’est fait pour aller vers une convergence par le haut, au-delà des cadres nationaux certainement pas immuables et indépassables à mes yeux. Le malaise de la gauche européenne vient de là pour partie.
M'enfin tout cela n'est que mon propre récit des « grands récits »…
17:35 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : mélenchon, social-démocratie, média



