16 août 2010
La crise du capitalisme en images
Trouvé sur le blog d'Abadinte
10:34 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : économie, capitalisme, humour
11 août 2010
Pourquoi il faut partager les revenus - Artus/Virard
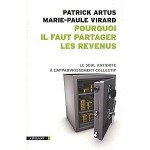 Patrick Artus, économiste et directeur de recherche de Natixis, et Marie-Paule Virard, journaliste économique indépendante, sont des prolifiques auteurs d’essais économiques « grand public » et prospectif : Le capitalisme est en train de s’autodétruire (2005), Globalisation, le pire est à venir (2008), Est-il trop tard pour sauver l’Amérique ? (2009). Pourquoi il faut partager les revenus est leur dernier ouvrage. Le titre est éloquent. C’est un intervenant sur le blog de Moscovici qui m’a donné envie de le lire.
Patrick Artus, économiste et directeur de recherche de Natixis, et Marie-Paule Virard, journaliste économique indépendante, sont des prolifiques auteurs d’essais économiques « grand public » et prospectif : Le capitalisme est en train de s’autodétruire (2005), Globalisation, le pire est à venir (2008), Est-il trop tard pour sauver l’Amérique ? (2009). Pourquoi il faut partager les revenus est leur dernier ouvrage. Le titre est éloquent. C’est un intervenant sur le blog de Moscovici qui m’a donné envie de le lire.
Dès l’introduction, les auteurs posent le cadre : la crise de 2007-2009 n’est pas une simple parenthèse, mais plutôt le point de départ d’une nouvelle phase de la globalisation. Cette nouvelle phase, qu’ils appellent « déglobalisation », serait marquée par le dynamisme autonome des pays émergents et la stagnation des économies occidentales, qui rencontrent les plus grandes difficultés à se réformer, et leur recul dans l’économie mondiale (I). Confrontés à un risque de spirale déflationniste à la japonaise (II), les économies développées ne peuvent plus compter sur les politiques économiques classiques aux effets limités, voir contreproductifs (III). La France peut s’en sortir en modifiant le partage des revenus entre salaires et profits (IV), mais surtout en œuvrant pour que se mette en place une véritable solidarité européenne (V).
Un nouveau contexte : la déglobalisation.
La déglobalisation est défini par les auteurs non pas comme la fin de l’ouverture économique et financière ou un retour du protectionnisme (retour perceptible dans certains combats douaniers ou dans le retour du contrôle des capitaux[i]) mais comme une situation où les échanges commerciaux sont moins dynamiques qu’avant la crise
L’économie internationale connait une évolution décisive, véritable menace pour les « vieux pays » : les pays émergents, où la demande intérieure est déjà repartie, substituent de plus en plus la production domestique aux importations. Il est illusoire pour les pays de l’OCDE d’espérer un soutien de leur croissance par la demande des pays émergents (soit nos exportations).
La part des pays émergents dans le commerce international augmente très rapidement : avec 12% du commerce mondial, la Chine est devenue le premier pays exportateur mondial. Par ailleurs, les économies émergentes sont passées d’une spécialisation « bas de gammes » à une spécialisation « haut de gammes ». La Chine par exemple a vu ses produits hauts de gammes passer de 21% des exportations chinoises en 1998, à 33% dix ans plus tard.
Cette montée en gamme s’explique par la diffusion de l’innovation depuis les entreprises étrangères, par le rôle de l’Etat (soutient aux industries de hautes technologiques), par le développement de l’éducation supérieure (on est passé de 2 millions de diplômés universitaires en 1982 à 80 en 2007), et par l’augmentation rapide de la productivité globale des facteurs (1999-2009 : une moyenne de 3,5% par an).
L’année 2010 devrait marquer le basculement du centre de gravité de l’économie mondiale vers les pays émergents. A eux seuls, les BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) représentent 50% de la croissance de la consommation mondiale. C’est la consommation domestique qui va constituer le moteur du dynamisme économique des pays émergents. Ces derniers vont tôt ou tard passer d’un modèle mercantiliste de croissance à un modèle de croissance basé sur la demande intérieure (développement rapide des classes moyennes et aisées).
Ce changement de modèle de croissance n’est pas sans conséquences pour les économies de l’OCDE, condamnées à une croissance durablement faible (le désendettement des ménages et entreprises, la multiplication de plans réduction des déficits publics et la faiblesse de l’emploi entretiennent une demande intérieure morose) et atteint par le phénomène de désindustrialisation (la France a perdu près de 2 millions d’emplois industriels depuis 1980, dont 500 000 perdus entre 2000 et 2008[ii]).
Les pays de l’OCDE devront faire face d’une part à une hausse des prix des matières premières (pétrole, plomb, argent, étain, zinc), conséquence de l’amélioration de l’activité industrielle des pays émergents et de l’excès de liquidité mondiale, et d’autre part à une hausse probable des taux d’intérêts à long terme qui devrait alourdir le poids de la dette.
Plus important encore, ce changement de modèle de croissance devrait modifier le régime de changes de certaines économies émergentes. Certaines stabilisent leurs monnaies par rapport au dollar pour conserver leur compétitivité prix, se privant par là même de l’outil monétaire. Par exemple, le lien fixe entre le dollar et le yuan empêche l’utilisation par la Chine de la politique monétaire comme instrument de régulation du taux d’intérêt et de contrôle de la création monétaire ou encore de la distribution du crédit.
Ainsi, la Chine soutient la monnaie américaine. Lorsque celle-ci se déprécie, la Banque centrale de Chine achète des dollars et crée ex-nihilo sa monnaie et acquiert des actifs en dollars sur le marché. Si les autorités chinoises décidaient de laisser flotter leur monnaie, les conséquences seraient sérieuses pour la zone euro et les Etats-Unis : d’une part, la dépréciation du dollar et de l’euro vis-à-vis des devises des pays émergents provoquerait une hausse des prix importés, donc une détérioration des termes de l’échange, et d’autre part, une augmentation des taux d’intérêt de long terme susceptible d’aggraver la dépression de la demande.
Prise dans sa dimension financière, la déglobalisation devrait conduire chaque région à ne compter que sur sa propre épargne pour financer sa croissance. Or l’épargne domestique des pays de l’OCDE est insuffisante. C’est l’épargne des pays émergents qui a financé tout au long des années quatre vingt dix les déficits publics américains et européens et l’endettement privé de ces mêmes zones. La déglobalisation financière va marquer la fin des conditions de financement très favorables pour les économies de l’OCDE.
Le spectre de la maladie japonaise : le risque de stag-déflation.
Le choc qui a déclenché la crise (excès d’endettement associé à des bulles sur les prix des actifs, crise bancaire lorsque les bulles éclatent, désendettement durable qui réduit la demande, inflation très faible qui fait monter les taux d’intérêts réels, freinage ou même recul des salaires) ressemble furieusement à celui ayant initié la dynamique déflationniste qui sévit le Japon depuis le début des années 1990.
A la fin des années quatre vingt, le Japon jouissait d'une grande prospérité économique, et enregistrait d’importants excédents commerciaux. Toutefois, en raison d’une politique monétaire accommodante, le surplus de liquidité engendré a fait progresser le niveau de crédit et le prix des actifs. L’indice du NIKKEI est passé de 13 000 à 39 000 points en trois ans, et les prix de l’immobilier ont augmenté de 60% pour la seule année 1989. La spéculation financière et immobilière était bien présente.
C’est la remontée des taux d’intérêt pour faire face au retour de l’inflation (conséquence de la tension sur le partage de la valeur ajoutée, du vieillissement, de la surchauffe économique) qui a provoqué le retournement économique et l’explosion de la bulle immobilière et financière. S’en est suivi un effondrement de la bourse et des prix des actifs et la multiplication des faillites bancaires.
Le Japon est alors entré dans un équilibre déflationniste : un taux d’inflation inférieur à zéro et une politique monétaire pro-cyclique. Celle-ci signifie que, plus les prix baissent avec la demande, plus les taux d’intérêts réels augmentent. En conséquence, les ménages et les entreprises sont alors prêts à tout pour préserver leur niveau de profitabilité (pression sur salaires, solder les stocks).
Ni la baisse des taux d’intérêt, ni les plans de relance ne viennent renverser la situation. Malgré deux plans de relance pour la seule année 2009 – celui de septembre 2009 (92 300 milliards de Yen soit 704 milliards d’euros) et celui du 7 décembre 2009 (7200 milliards de Yen soit 1,5 point de PIB) – la récession était de 5,7% en 2009. La croissance japonaise moyenne entre 1992 et 2008 était inférieure à 2%.
Afin de satisfaire les actionnaires très exigeants sur le rendement du capital et de préserver des capacités d’autofinancement au moment où l’épargne privée est confisquée pour le financement des déficits publics, les entreprises cherchent à diminuer les salaires. Résultats : destruction des capacités de production, délocalisation et pertes d’emplois (-20% sur 10 ans), dette publique atteignant presque 200% du PIB.
L’hypothèse d’un scénario déflationniste à la japonaise pour la zone euro et les Etats-Unis n’est pas à exclure.
La chute des prix d’actifs a conduit à un recul de l’inflation et au frein sur les salaires, ce qui pèse sur la consommation et la demande. Et comme l’épargne est captée par le financement des déficits publics, on enregistre une baisse des investissements privés et des salaires nominaux (baisse du temps de travail, baisse en général du salaire, multiplication du temps partiel), qui maintient la faiblesse de la demande.
Les limites des politiques économiques classiques
|
| Zone euro | France | Japon | USA | Royaume-Uni |
| Déficit public | 6,3% | 7,9% | 8% | 9,9% | 12,9% |
| Dette publique | 78,8% | 77,2% | 1832% | 53,% | 73,2% |
Entre 1998 et 2007, les pays de l’OCDE ont sauvé leur croissance via le développement du crédit (qui a remplacé le revenu, laminé par la globalisation) permis par une politique monétaire expansionniste. Il a été calculé que sans l’endettement du secteur privé, la croissance aurait été environ de 2% aux USA (contre 4%) et de 1% dans la zone € (contre 2-3%).
Vertus et limites des déficits.
Lorsque le crédit a été coupé, la part de la demande privé financée par le crédit s’est évaporé (biens des ménages, investissements pour les entreprises ou développement du commerce international) d’où le recours à des plans de relance massifs. Mais si la relance budgétaire (sous forme de baisse d’impôt ou d'augmentation de la dépense) a permis un redémarrage de la consommation[iii], il faut creuser toujours plus le déficit pour augmenter l’activité (effet dynamique).
Or l’effet normalement positif du déficit budgétaire (logique du multiplicateur keynésien) est atténué voir anesthésié par le phénomène d’anticipation des agents économiques : l’épargne de précaution (tout hausse du déficit dans le présent non compensé par des impôts immédiats est perçu comme des impôts futurs, les ménages préfèrent alors épargner en prévision des futurs prélèvements). Le taux d’épargne des ménages français est ainsi remonté à 17%.
La monétisation des déficits publics, un engrenage diabolique.
Sachant que les besoins de financement public étaient supérieurs à ce que les investisseurs privés (banques, assurances, fonds d’investissements) étaient prêts à financer en achetant des titres publics sur les marchés, les banques centrales n’ont pas hésité à organiser le rachat (ou la prise en pension) par les banques de titres publics avec en contre partie, une création monétaire ex-nihilo (les banques centrales achètent obligations émises par les administrations qui reçoivent en échange de quoi financer leurs dépenses).
En situation d’insuffisance de la demande mondiale (sous-emploi), d’excès d’épargne et de faiblesse de l'inflation, on peut supporter une politique économique expansionniste. Mais la base monétaire a encore augmenté (+30%), ce qui laisse entrevoir de nouvelles bulles spéculatives en formation (ex : sur le cuivre, le sucre, l’or, l’immobilier du luxe etc).
La guerre des taux de change est devant nous.
La guerre des taux de change est une tentative de gagner des parts de marché en sous évaluant la monnaie. Avec un dollar faible comme ce fut le cas entre 1994 et 1999, puis entre 2005 et 2008, le commerce extérieur américain s’était amélioré.
Mais lorsque le dollar baisse, le yen et l’euro subissent l’essentiel de l’ajustement alors que ces économies sont déjà en déflation (Japon) ou connaissent un important risque de déflation (zone euro). Ce faisant les américains améliorent leur compétitivité (moins dépendant de la demande intérieure) et transfèrent les risques déflationnistes sur des pays à devises flexibles et à faible autorité politique.
Un nouveau partage, l’antidote à l’appauvrissement collectif.
Artus et Virard appellent à en finir avec un modèle de capitalisme qu’ils jugent exténué. Ce modèle, fondé sur la gestion des entreprises au profit des actionnaires, la faiblesse des salaires mal compensée par le crédit et le développement de création d’emplois dans les secteurs liés au crédit (distribution, construction), fait des salaires la variable d’ajustement privilégiée.
La déformation du partage de la valeur ajoutée entre salaires et profits qu’on observe depuis une vingtaine d’années devrait non seulement durer mais s’amplifier. En effet, quand il y a moins de richesse créée, le conflit sur sa répartition augmente : l’Etat voit ses recettes fiscales diminuer, les entreprises voient leurs profits baisser et les ménages voient diminuer le nombre d’emploi et le niveau de salaire.
Or les entreprises doivent faire face à une croissance plus faible de leur activité et satisfaire les exigences de leurs actionnaires, ce qui accentue la pression sur les salaires. Les exigences des actionnaires sont d’autant plus fortes que la politique monétaire est accommodante : l’excès de liquidité fait que l’argent devient bon marché, ce qui encourage la spéculation, donc l’investissement boursier.
Artus et Virard proposent alors d’infléchir le partage en faveur des revenus dépensés.
Réformer la fiscalité :
- Diminuer la pression fiscale sur le travail (baisse des charges sociales) compensée par une hausse de la pression fiscale sur les revenus du capital.
- Augmenter les salaires bas et moyens via un transfert prélevés sur les profits non investis et les revenus du capital non dépensés.
- Harmoniser la taxation des plus values en capital à court terme au niveau international
Modérer l’exigence de rendement du capital des investisseurs :
- Les pouvoirs publics doivent jouer leur rôle d’actionnaire avec un objectif de rentabilité inférieur à la norme privée (via la Caisse des Dépôts et des Consignations et le Fond Stratégique d’Investissement – doté de 14 milliards d’euros – tout en laissant la sélection des projets au secteur privé).
- Modifier les normes comptables (IAS) et prudentielles (Solvency II) afin que les investisseurs de long terme puissent investir davantage dans le capital des entreprises.
Stimuler la demande via la baisse des prix : faire disparaitre les rentes d’oligopoles (barrières à l’entrée)
Mener une politique spécifique d’emploi ciblé sur les jeunes :
- Lutter contre le chômage des jeunes via la formation et l’apprentissage en alternance
- Mettre en place des quotas d’embauche pour les jeunes diplômés (contrat en alternance etc)
L’impératif de solidarité européenne.
Toute union monétaire est une machine à fabriquer de la divergence entre économies dès lors qu’il n’existe aucun mécanisme stabilisateur susceptible d’absorber les chocs pouvant affecter tel ou tel pays (dit choc asymétrique).
L’union monétaire n’est une zone monétaire optimale définie par Robert Mundell selon deux conditions : il ne doit pas avoir de chocs asymétriques, et les facteurs de production (travail et capital) doivent circuler librement.
En l’absence de politique concertée sur le plan social (marché du travail), budgétaire ou fiscal, chaque Etat membre a mis en œuvre une politique économique et industrielle qu’il considérait comme la plus conforme à ses intérêts.
Cela a produit des spécialisations productives différentes : c’est le cas de l’Allemagne et de l’Espagne.
| Allemagne | Espagne |
| Modèle axé sur la compétitivité-coût, l’industrie haut de gamme, et le dynamisme des exportations. Cela a conduit à une compression des coûts salariaux et à une politique de désinflation compétitive menée au détriment des autres Etats membres de la zone. | Modèle centré sur le dynamisme du secteur de la construction et de celui du tourisme. Pauvre en gains de productivité et marqué par un fort endettement des ménages. Bons « ratios » : excédent budgétaire (2% du PIB), forte croissance (4%), créations d’emplois et rattrapage salarial. |
La politique monétaire n’a pas été sans effet :
- Lorsque le taux de croissance > taux d’intérêt => économie stimulée (endettement, hausse prix des actifs)
- Lorsque le taux de croissance < taux d’intérêt => situation inversée
A l’heure actuelle, la zone euro ne peut revendiquer une mobilité totale du facteur travail ou l’existence d’une solidarité budgétaire (système de redistribution des prestations sociales). Le budget communautaire est très faible (1,1% du PIB) et les traités n’autorisent pas d’aides directes entre les Etats (no bail out).
Leurs propositions pour une solidarité européenne :
- Etablir un dispositif d’aide mutuelle (l’accord du 25 mai 2010 est un premier pas en la matière)
- Afficher des objectifs réalistes de réduction des déficits publics sans casser la reprise.
- Mettre sur pieds une supervision macroprudentielle
- Faire converger les économies par rapprochement des législations fiscales et sociales.
[i] Le Brésil a fixé un taux d’entrée des capitaux à 2 %
[ii] Les disparitions d’emplois dans l’industrie serait pour 25% du au phénomène de tertiarisation, 30% du aux gains de productivité, et 45% à la concurrence étrangère.
[iii] Sans transfert public, le revenu consommable américain aurait été inférieur de 9% à celui dont les ménages américains ont disposés en 2009
00:04 Publié dans Livres | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : économie, moscovici
04 avril 2010
DSK, la rupture au FMI
Erik Izraelewicz - Tribune
* * *
DSK candidat à l'Élysée ? À Washington, le chouchou des Français a révolutionné le FMI. Il en a refait un pouvoir qui compte. Et il y a pris goût. Alors, présider la France ou influer sur le monde ?
Juin 2011, le sacre de Cannes. Le sacre, ce ne sera ni celui de Nicolas Sarkozy, l'hôte du G20 dans la capitale du cinéma, ni celui de Martine Aubry, la star des primaires du PS, ce sera en réalité celui de Dominique Strauss-Kahn. Un an avant les présidentielles, Cannes recevra les chefs d'État et de gouvernement du G20 ? Obama, Merkel, Hu Jintao, etc... Et celui que tous écouteront, ce sera le patron du FMI, DSK. En moins de trois ans, Dominique Strauss-Kahn a remis le Fonds au centre du monde. Il y a organisé une véritable « rupture ». Quand le professeur d'économie s'était installé, le 1er novembre 2007, à Washington, le FMI était une institution moribonde, sans moyen et en panne de légitimité. La crise aidant, pierre à pierre, DSK a reconstruit un « nouveau FMI ». Avant Cannes, on devrait pouvoir visionner les premiers rushes de ce FMI relooké dès cette année, lors de l'assemblée annuelle du Fonds, fin avril à Washington.
Le Fonds, une caserne de pompiers
En 2007, le FMI était le « grand méchant loup » que personne ne voulait accueillir. Les pays en difficulté financière ? l'Argentine à l'époque ? ne voulaient surtout pas de son aide. Aujourd'hui, ils frappent tous à sa porte ? l'Islande, la Lettonie, la Hongrie, etc... Dernier exemple en date, et pas le moins spectaculaire, l'Europe a appelé le FMI au secours de l'un des siens ? la Grèce. En moins de deux ans, l'institution est redevenue le sauveur des nations menacées de faillite. La crise a rendu nécessaire la présence, dans le monde, d'une caserne de pompiers, c'est vrai. Mais DSK a su habilement jouer de l'héritage du Fonds tout en le modernisant pour s'imposer comme le pompier en chef. Il a obtenu un renforcement considérable des moyens financiers de l'organisation internationale. Il a su aussi impulser des plans de sauvetage plus subtils que ceux inspirés du « consensus de Washington ». A la vingtaine de pays que le Fonds a aidés depuis qu'il le dirige, il a imposé des plans d'austérité sans toujours passer par des coupes brutales dans les dépenses sociales.
Un cabinet médical, une boîte à idées
En 2007, personne n'écoutait les recommandations du FMI. Aujourd'hui, elles sont incontournables. En janvier 2008, DSK lançait, à Davos, un cri d'alarme face à une situation économique mondiale qu'il annonçait gravissime. Un an après, il appelait tous les pays du monde à mettre en oeuvre des plans de relance massifs ? dans une optique très keynésienne. Il recommandait aux grandes nations de laisser filer leur déficit et d'injecter l'équivalent de 2 points de PIB dans l'économie pour éviter une dépression du type de celle des années 30. Ce qui fut fait. Aujourd'hui, il demande aux grandes puissances de ne pas relâcher trop tôt leurs efforts. Et il est écouté.
Mais le FMI n'est pas qu'un cabinet médical qui distille ses ordonnances à ses patients malades, il est aussi redevenu la plus influente des boîte à idées du monde. Avec ses copains économistes parfois iconoclastes, DSK a d'ores et déjà bousculé quelques-unes des vaches sacrées de la « pensée unique » - entendre de celle des banques centrales traditionnelles. L'inflation ? Peut-être qu'une petite dose ? 4 % au lieu de 2 % - pourrait bien être utile, disent ses gourous, au grand dam de Trichet, Bernanke et Weber. Le contrôle des mouvements de capitaux ? Pourquoi pas dans certaines circonstances. La taxation des banques ? Le FMI de DSK a été chargé de faire des propositions sur ce sujet au G20. Elles seront remises aux dirigeants du G20 avant la fin de ce mois. DSK rejette la taxe Tobin, mais plaidera pour une police d'assurance payée par tous les établissements financiers en fonction des risques qu'ils prennent. Il a d'ores et déjà eu l'habileté de ne pas parler d'une nouvelle taxe (genre « taxe carbone ») qui serait immédiatement assimilée à un impôt et de fait rejetée rapidement par tous ceux que l'impôt exaspère. Il s'agirait, subtilité, d'un « financial fee », d'une commission donc !
Les vaches sacrées, toutes bousculées
Ayant acquis quelque assurance, DSK cherche à pousser maintenant son avantage. Il n'hésite pas à donner son avis sur tous les sujets ? la politique macro-économique de l'Américain Obama, la politique de change du chinois Hu Jintao, le fonctionnement de la zone euro, etc... Sans que personne ne le lui demande, il multiplie les propositions. Les deux dernières en date ? un « fonds vert » et un FMI police de la finance mondiale - sont de véritables pavés dans la mare. À son initiative, le FMI a proposé de créer un « Fonds vert » qui lèverait 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020 pour aider les pays pauvres à se doter de technologies vertes. Le Fonds a, toujours sous son impulsion, fait explicitement acte de candidature pour assurer la supervision du système financier mondial. Il veut faire du FMI la nouvelle tour de vigie de la finance mondiale. Les maîtres du monde ne viennent-ils pas tout juste de créer, avec le Conseil de stabilité financière, une institution pour cela. DSK n'est pas totalement convaincu que les banquiers centraux sont de bons économistes, pas plus que de bons gendarmes. Pas sûr néanmoins que ses « actionnaires » - ses 185 États membres de l'organisation - approuvent cette extension souhaitée du champ d'activité du Fonds. DSK ne manque pourtant, dans ces deux combats, ni d'arguments, ni d'alliés.
Le vrai pouvoir, à Paris ou à Washington ?
Pour réinstaller ainsi le FMI au centre du monde ? sans avoir eu besoin du nouveau Bretton Woods demandé par Nicolas Sarkozy ?, DSK a profondément transformé l'institution de l'intérieur aussi. Il a obtenu une nouvelle répartition des droits de vote au sein de son conseil. Il a réduit et rajeuni les effectifs de l'organisation. Il y a fait entrer du sang neuf ? il va accueillir, le 3 mai prochain, à ses côtés, un nouveau « conseiller spécial »,un Chinois, Zhu Min, le numéro deux de la banque centrale chinoise. Après avoir ainsi organisé, avec une discrétion et une efficacité redoutables, la « rupture » au FMI, DSK souhaitera-t-il demain revenir batailler dans l'Hexagone ? Alors qu'à Paris, on s'interroge sur son éventuel retour, avec inquiétude ou espoir, c'est selon, la question mérite d'être posée. Avec son « nouveau FMI » et alors que son mandat court jusqu'à novembre 2012, DSK peut espérer influer sur les affaires du monde autrement que depuis un bureau à l'Elysée, sans que cela d'ailleurs ne l'empêche de peser un jour aussi sur le sort de la France ? quand celle-ci, pour cause d'endettement excessif, sera obligée d'aller frapper à la porte du Fonds.
00:00 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : dsk, économie
02 décembre 2009
Réjouissantes perspectives
A l'université d'été de La Rochelle de cette année, Martine Aubry avait annoncé la tenue d'une convention sur le nouveau modèle économique et social à construire. Cette convention sera présidée par Pierre Moscovici et devrait avoir lieu après les élections régionales de mars prochain. On en sait un peu plus désormais sur l'organisation de ce stimulant travail intellectuel. Il y aura donc trois grands thèmes, subdivisés en treize ateliers. Voilà de réjouissantes perspectives !
Thème 1 : Un nouveau modèle de d'éco-développement au service du progrès
Atelier 1 : Un nouveau modèle de production pour sortir de la crise, une stratégie industrielle pour préparer l'avenir
Atelier 2 : Accélérer la mutation social-écologique de notre économie et de nos modes de consommation
Atelier 3 : Une politique énergétique pour la diversification, l'indépendance et la sécurité des approvisionnements
Atelier 4 : Commerce international : quelles politiques pour un juste échange ?
Atelier 5 : La recherche et l'innovation au service d'une nouvelle croissance
Thème 2 : Relancer le progrès social
Atelier 6 : Plein emploi, bon emploi : de nouveaux outils pour l'égalité réelle
Atelier 7 : Pouvoirs, propriété et gouvernance dans l'entreprise : de nouvelles règles pour un juste partage des richesses et l'amélioration des conditions de travail
Atelier 8 : Pour la société du bien-être : refonder la protection sociale
Thème 3 : Réhabiliter l'intervention publique
Atelier 9 : Réarmer l'Etat et la puissance publique, développer les services publics, distinguer les biens publics et les biens privés
Atelier 10 : La révolution budgétaire et fiscale au service de la justice
Atelier 11 : De nouveaux outils pour un monde solidaire et durable
Atelier 12 : Réorienter l'action publique européenne
Atelier 13 : Le nouveau modèle de développement et les territoires
22:28 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : ps, économie, aubry, moscovici
13 juin 2009
Retour sur les résultats des européennes 2009
Me voilà de retour après cinq jours en déplacement à Pau. Bien qu’un peu épuisé par des journées de travail assez longues – obligation de finir le chantier pour aujourd’hui – je suis content de m’être déconnecté du net quelques jours et surtout, d’avoir pu changer totalement d’environnement après trois semaines de relatif farniente à la maison. Toutefois, ces vacances – au sens premier du terme – ne m’ont pas empêché de penser un peu aux résultats des élections européennes du weekend dernier.
L’enjeu majeur de ces élections, en tout cas tel que je l’ai appréhendé en tant que citoyen, était de savoir quelle majorité politique nous souhaitions, pour les cinq ans à venir, au Parlement européen (PE). Concrètement, le scrutin européen consistait à choisir entre la reconduction des conservateurs (rassemblés au sein du Parti populaire européen), adeptes de la non-intervention de la puissance publique dans l’économie et réticents à l’approfondissement de la construction politique de l’Europe, et les forces de gauche, avec en tête les socialistes européens. Ces derniers, pour la première fois depuis l’élection du PE au suffrage universel, ont proposés un texte commun-programme, le Manifesto, pour un véritable changement en Europe.
Les urnes ont parlées. L’abstention est la grande gagnante de cette élection (en qualité d’assesseur le jour du vote, j’ai bien vu que les gens de ma commune ne se bousculaient pas pour voter), les européennes ne passionnant décidément pas les peuples européens, même ceux qui « profitent le plus » de l’Union européenne. Mais sur le plan électoral, la droite reste majoritaire au PE et gagne même des sièges. Les libéraux (ADLE) et les Verts progressent un peu. Les grands perdants restent les socialistes. En France le PS, loin derrière l’UMP et talonné par Europe-Ecologie, enregistre un de ses plus mauvais résultats électoraux. Il perd la moitié de ses élus par rapport à 2004. Je dois avouer que je n’imaginais pas qu’on pourrait tomber si bas. Cela dit je ne m’attendais à pas un grand score non plus.
Après le temps de la déception, vient le temps de l’analyse, de la compréhension de ce résultat. Il faudra bien en tirer des leçons pour l’avenir. Au niveau du résultat européen, je retiens trois facteurs pouvant expliquer le mauvais score du PSE. D’abord la mauvaise image des partis socialistes/sociaux-démocrates dans les « nouveaux » entrants, où le socialisme est encore assimilé au communisme soviétique (j’ai pu le vérifier en parlant politique avec mes amies polonaises). Ensuite, le nombre de sièges par pays étant accordé selon le critère démographique, la défaite (ou stagnation) des socialistes dans les « grands pays » (Allemagne, France, Italie, Grande-Bretagne, Espagne, Pologne) entraine une baisse automatique sur le nombre total d’élus socialistes au PE. Enfin, malgré une crise économique et financière qui réhabilite les idées de régulation et du rôle de la puissance publique dans l’économie, thèmes chers aux socialistes, ces derniers ne parviennent pas à se faire entendre et à se démarquer suffisamment de la droite, quand ils ne sont pas désignés comme coresponsables de la dite crise pour leur gestion de l’économie dans les années quatre vingt dix.
Le faible score du Parti socialiste français peut s’expliquer par au moins cinq raisons. Ces raisons n’ont pas le même poids : certains facteurs sont structurelles, d’autres conjoncturelles, certains sont prédominants quand d’autres sont marginales.
Il y a d’abord ce que j’appelle l’effet balancier : lorsqu’un des grands partis recueille le plus de sièges à une élection, il lui est difficile d’égaler et encore plus d’augmenter son résultat à la prochaine élection. Du coup, il part « perdant » et il y a comme un effet de balance qui joue en faveur de son concurrent. C’est ce qui est arrivé à la droite aux municipales l’année dernière par rapport au très bon score de 2001. C’est ce qui est arrivé au PS aux européennes et c’est ce qui l’attend vraisemblablement demain aux régionales.
La désunion des socialistes peut être une deuxième raison de cette défaite. Le congrès de Reims en novembre dernier n’a pas permis de réaliser la synthèse – que tous les acteurs condamnaient – ou de dégager une majorité franche, le parti étant grosso-modo coupé en quatre forces à peu près égales. L’élection du Premier secrétaire n’a pas davantage aidé à la clarification puisque la victoire de Martine Aubry sur Ségolène Royal s’est jouée à quelques voix. Un si faible écart de voix et l’arbitrage de la commission de recollement, dont la composition est basé sur le score des motions, n’a pas donné une légitimité suffisante à Martine Aubry. Les accusations mutuelles et publiques de tricheries et les menaces, elles aussi publiques, d’action judiciaire ont porté un coup à la crédibilité politique et électorale du PS. La composition de la direction du PS n’a pas reflété le poids obtenu par chaque motion à Reims alors qu’en l’absence de majorité, c’était la solution la moins mauvaise. Pendent près de six mois, quelque soit le travail et la position du PS, il s’est toujours trouvé un socialiste pour venir dans les média en faire la critique : Rebsamen vis-à-vis du contre plan de relance, Lang vis-à-vis de la loi d’Hadopi, Collomb ou Peillon vis-à-vis du déroulement de la campagne des européennes… Durant cette campagne, certain(e)s militants ont fait le service minimum, quand d'autres étaient aux abonnés absents. Comment peut-on avancer dans ces conditions ?
Troisièmement, la campagne socialiste a connu des ratés. L’organisation des meetings manquait de préparation. Pour ne prendre qu’un exemple, le meeting de lancement de campagne à Toulouse a été décidé à peine trois semaines avant, et les tracts à distribuer à cet effet ont été livrés à la fédé quasiment la veille ! Seuls deux tracts nationaux (à ma connaissance du moins) ont été prévus pour toute la campagne avec un message insuffisamment mobilisateur. L’appel au vote sanction (à Sarkozy et à Barrosso) ne constitue pas un vote positif (« en faveur de ») et porteur d’espoir, mais un vote par défaut. Outre que la logique était reprise par d’autres partis, elle ramenait la campagne à une dimension trop nationale. Toutefois, lorsqu’on voit les satisfecit de la droite le soir des résultats (« Tout le monde dit I love you à Sarkozy » selon Karoutchi, « un soutien aux réformes du gouvernement » pour d’autres), on peut se demander si ce n’était pas pertinent au regard des principes. Il me semble que le PS a insuffisamment mis en valeur le Manifesto et ses propositions pour les 100 jours à venir. Enfin, il s’avère que le bulletin de vote pour les listes PS n’était si facilement identifiable.
Par ailleurs, je pense que les socialistes français ont payés la fracture européenne du référendum de 2005 (ouiste et noniste) et l’adoption du traité de Lisbonne par voie parlementaire en 2007. Certes, le camp du non de gauche en 2005 (une partie du PS, le PC, la LCR, LO, MDC, altermondialistes), qu’il est difficile d’identifier aujourd’hui tant la configuration politique a changé, n’a pas recueillis autant de voix qu’on ne l’aurai cru (Front de gauche, LCR, LO), mais le départ de Mélenchon de la famille socialiste a sans doute contribué à éloigner quelques voix – à mon avis les plus politisés – du vote socialiste. Quant à l’adoption du traité de Lisbonne par le Parlement français, il est considéré comme une confiscation de la démocratie. Pourtant Sarkozy avait été clair sur le sujet pendant les présidentielles : il négocierait un mini-traité par voie intergouvernementale (sans passer par la case comité paneuropéen et non politique comme ce fut pour le TCE) et le ferait adopter par voie parlementaire. Le PS, qui n’en a pas été l’initiateur et n’avait pas son mot à dire quant au choix du mode d’adoption, ne pouvait pas faire grand-chose de plus.
Enfin, malgré l’élaboration et la proposition d’un texte-programme commun à tous les partis socialistes, sociaux-démocrates et travaillistes européens, la campagne des socialistes européens, déclinée et adaptée à chaque pays et culture nationale, a cruellement manqué de coordination. Alors que l’élection du Parlement européen devrait mettre en valeur un intérêt général européen, chaque parti semble rester sur la défense du statut quo européen (co-gestion entre le PSE et le PPE) et la logique de ses intérêts nationaux (en particulier lorsque le parti est au gouvernement). Les socialistes européens avaient beau appeler à changer la majorité du PE et à une nouvelle composition de la Commission, ils ont été incapables de s’accorder sur le nom d’une personnalité alternative à celle de Barrosso. Pire ! Les socialistes espagnols et portugais, les travaillistes anglais et les sociaux-démocrates allemands ont soutenu plus ou moins ouvertement la candidature de Barrosso : les Portugais par solidarité nationale ; les Espagnols pour conserver deux puissantes commissions (sauver la place à Joaquim Almunia et à Javier Solana) et préparer la présidence espagnole de l’UE prévue de janvier à juillet 2010 ; les Anglais pour s’assurer que la Commission ne viendra pas réglementer la finance européenne dont la City est la pierre angulaire et le moteur de la croissance britannique ; les Allemands enfin, pour s’assurer une répartition à peu près égale des postes européens revenant à l’Allemagne entre la CDU et le SPD qui forment actuellement un gouvernement de coalition. Sans doute que le PS français a eu tord de focaliser sa campagne sur la personne de Barrosso mais avec des alliés pareils, il est difficile de croire en une alternative politique.
Et maintenant ? J’ai beau ne pas être très optimiste sur l’avenir du PS comme force alternative au sarkozysme, je ne participerai pas à l’autoflagelation ambiante, exercice qu’affectionnent certains camarades, ni à l’écriture de scénario de politique-fiction de ceux qu’on appelle encore aujourd’hui, « journalistes ». Ceux qui au PS croient qu’il faut un nouveau congrès ou qu’avec une autre personnalité à sa tête on aurait fait mieux, n’ont visiblement rien compris. Royal sans les hommes et femmes fortes du PS, qu’elle a volontairement écarté par rejet de la « jospinie », n’a pas pu gagner en 2007, Aubry et les autres n’ont pas pu gagner davantage les européennes sans Royal et ses amies. De mon expérience militante locale, j’ai appris qu’on ne peut pas fonctionner en écartant les uns et les autres selon sa convenance personnelle. L’Unité et la solidarité militante est la condition première d’un retour des socialistes. Mais l’ambiance est tellement pourrie qu’elle semble compromise, voir improbable. Le retour des socialistes ne peut passer que par un vrai travail de refondation – organisationnelle et programmatique – du plus vieux parti de France. Mais le verbe n’est pas l’action, et on attend du PS qu’il fasse ce travail et cesse de rester dans l’incantatoire (« y’a qu’à », « faut qu’on »).
Garder son esprit critique sur son propre parti est nécessaire, n’avoir que la critique à l’esprit est par contre suicidaire d’un point de vue collectif. L’ambiance nationale et locale font que je ne suis pas certain de rester militant socialiste encore très longtemps. On verra…
16:12 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : europe, social-démocratie, élections, économie, europe-écologie, aubry, royal, mélenchon



