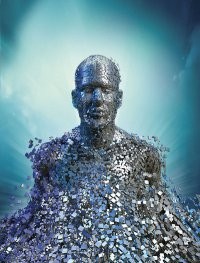30 mai 2011
Et l’homme créa un dieu
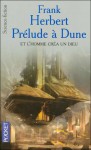 Pour tous ceux qui ont découvert le talent et le génie de Frank Herbert par la saga Dune, et qui sont tombés amoureux de cet univers, il convient de dissiper d’entrée tout malentendu lié à la première page de couverture. Bien que sous-titré Prélude à Dune, Et l’homme créa un dieu n’a pas de liens directs avec cet univers. On retrouve cependant les thèmes chers à Frank Herbert.
Pour tous ceux qui ont découvert le talent et le génie de Frank Herbert par la saga Dune, et qui sont tombés amoureux de cet univers, il convient de dissiper d’entrée tout malentendu lié à la première page de couverture. Bien que sous-titré Prélude à Dune, Et l’homme créa un dieu n’a pas de liens directs avec cet univers. On retrouve cependant les thèmes chers à Frank Herbert.
Marqué par une lointaine et mystérieuse Guerre des Marches, la galaxie s’assure l’unité et la paix entre civilisations par les services Redécouverte et Rééducation (le R.R), chargé de redécouvrir les planètes autrefois affiliés à l’Empire et d’y enseigner la paix civile, et Investigation et Normalisation (l’I.N), chargé d’employer la manière forte en cas de menaces guerrières avérées.
L’histoire se centre sur le personnage de Lewis Orne, agent R.R tout juste diplômé de l’Ecole de la Paix, et envoyé sur une planète récemment redécouverte et où l’on enregistre de nombreuses disparitions. L’homme semble des plus banals mais abrite en lui une sorte de pouvoir de préscience, faisant preuve d’un sens aigue de l’observation et d’immenses capacités d’intuition.
Plus ou moins supervisé par Stetson, un agent de l’I.N convaincu de son potentiel, Lewis Orne va mener plusieurs missions suicides pour assurer la paix, et déjouer le contre-pouvoir des Nathians. Ses grandes capacités et son expérience de quasi mort imminente l’assimilent à un « faiseur de miracles », un « dieu en puissance », aux yeux des Prêtres du Surdieu. Seules les épreuves finales permettront de déterminer qui il est réellement.
Plutôt court, le roman se lit assez rapidement d’autant plus que le style est ici accessible. Rien à voir avec Destination Vide, un autre roman de Frank Herbert dont j’aurai l’occasion de reparler, où le jargon scientifique égare le lecteur. Le livre ouvre la réflexion sur la relation entre religion et pouvoir, entre créateur et créature, entre paix et guerre, et sur les potentialités de la conscience humaine. On en revient à la notion de post-humanité dont j’avais parlé l’été dernier.
L’intrigue est moins complexe que celle de Dune. Les défis rencontrés par Lewis Orne apparaissent comme des étapes dans la trajectoire personnelle du héros, montrant une progression du personnage du statut d’homme banal à celui de surhomme. Ici c’est moins l’environnement que le personnage qui compte, à la différence de Dune. Mais cela n’enlève rien à la qualité de l’histoire et de la narration. Et c’est avec plaisir que j’ai relu Frank Herbert.
16:11 Publié dans Livres | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : science-fiction, frank herbert
15 mai 2011
Désintégration ?
J'apprends ce matin l'arrestation de DSK par la police de New York pour agression sexuelle présumée. Certains cachent mal leur plaisir de voir le "candidat favori" du PS et de la gauche face à Sarkozy, tomber. François Bayrou, Bernard Debré et Marine Le Pen sortent les couteaux et piétinent au passage le principe de présomption d'innocence.
De toute façon dans la sphère politico-médiatique d'aujourd'hui, on est présumé coupable d'entrée. Et si par chance, on est lavé de toutes accusations par la justice, il restera des soupsons, des non-dits, comme quoi la justice n'aurait pas fait son travail correctement. Le mal est fait.
Et maintenant ? Soit, on découvre dans les deux mois qui viennent qu'il s'agit d'un coup monté, et alors DSK pourra concourir aux primaires, plus ou moins renforcé ou affaibli selon l'impact de l'affaire sur les consciences. Soit, l'affaire n'est pas réglée ou pire, sa culpabilité est avérée, et alors c'est fini pour lui... et pour nous en 2012.
12:14 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : dsk, média
01 mai 2011
Le travail en mutation
Aujourd’hui 1er Mai, c’est la Fête du Travail et des Travailleurs. Difficile de célébrer ce jour quand on sait le nombre de personnes privés de travail en France, en Europe et dans le monde, du fait de la crise surtout mais pas seulement. Pourtant le travail occupe une place centrale dans nos vies de manière générale et dans notre système économique en particulier.
Au niveau individuel, de manière schématique, on peut dire que chacun y consacre 8 heures par jour, 5 à 6 jours par semaine, 47 semaines par an, 42 années de sa vie. Sans minimiser l’importance et le temps consacré à la vie familiale et sociale, la vie professionnelle domine le quotidien.
Le travail procure à celui qui en a une identité et un statut social. On noue beaucoup de relations via le monde du travail. On nous défini généralement par notre travail plus que par nos traits personnels. Le travail fournit des revenus qui, à travers des modes de consommation qu’ils permettent, nous situent dans la hiérarchie sociale.
Sachant tout ceci, se retrouver en situation de demandeur d’emploi de longue durée ou allocataire prolongé de minima sociaux est un drame humain et social. C’est le problème de l’image qu’on a de soi et celle que nous renvois les autres, si prompts à coller des étiquettes. Les autres, les polytraumatisés (il n’y a là rien de péjoratif dans mon esprit), ne se posent peut être plus ces questions.
Mais si être exclu du marché de l’emploi est un drame social, et il doit être vu comme tel collectivement, le fait d’être pourvu d’un travail ne met personne à l’abri aujourd’hui d’autres difficultés. Je pense à la question des travailleurs pauvres mais aussi au mal-être au travail. L’actualité récente nous a livré quelques exemples tragiques de salariés mettant fin à leurs jours à cause de leur travail.
Les mutations de l’économie survenues au début des années soixante-dix expliquent en grande partie l’émergence et la résistance du chômage. L’essoufflement du modèle de régulation keynésien-fordiste, la quasi-satisfaction de le demande en biens d’équipements et autres biens courants, le progrès technique (automatisation puis informatique), la tertiarisation, ont fait basculé l’économie dans le sous-emploi.
Aujourd’hui, on produit autant, en moins de temps, et avec de moins en moins de mains-d’œuvre. Le développement des services et la concurrence internationale ont contribués à la fragmentation du temps de travail (le just in time, le toyotisme) et à externaliser de nombreuses opérations jusqu’ici assurées par les entreprises-mères. D’où la sous-traitance (parfois en cascade), l’intérim et le temps partiel etc.
L’individualisation des rapports sociaux (et donc professionnels) est un phénomène économique (fruit de la tertiarisation, désindustrialisation, et externalisation) et social (consumérisme différencié, stratégies face au chômage, augmentation du niveau éducatif), placé au cœur des nouveaux modes de managements. La financiarisation des stratégies d’entreprises (obligation de performance et de rentabilité) vient accroitre la pression sur le salariat.
Avec l’essor du management « participatif » (le cadre va fixer lui-même ses objectifs, développement des primes d’intéressements ou aux résultats, on parle de collaborateurs) et des NTIC (internet, e-commerce, e-travail), on a voulu (nous faire) croire que le fonctionnement en réseau effaçait toute hiérarchie, toute relation de pouvoirs et toute divergence d’intérêts.
Or toute relation de travail est fondée sur un pouvoir de négociation inégal et des intérêts divergents, que l’intérêt de l’entreprise commande de rapprocher, et que seule l’intelligence de chacun facilitera. Dans ces relations difficiles, non dénués de tensions et d’une certaine violence plus ou moins policée, c’est tout le rôle du droit du travail que de définir le cadre de régulation de ces rapports sociaux particuliers.
17:53 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, capitalisme, europe
23 avril 2011
Les Trois Lois de la Politique
Petit clin d'oeil à Isaac Asimov et ses Trois Lois de la Robotique. Mais plus que des "lois", au sens des sciences sociales plutôt qu'au sens des sciences dures, ce sont surtout les trois conclusions que j'ai tiré de l'observation des rapports du Politique aux Média.
- On ne meurt jamais définitivement en politique, sauf à y renoncer une fois pour toute. Et l'histoire politique a montré plusieurs cas de rebondissements et retours inattendus (Mitterrand, Chirac etc).
- Plus on est exposé médiatiquement et plus on s'use politiquement. Le rythme médiatique est mortifère. Sarkozy a tenté la saturation de l'espace médiatique au début de son mandat, ça n'aura pas durer.
- Tous les hommes et femmes qui font la surprise politique d'une élection à un moment donné, ne peuvent pas tenir la distance éternellement. Les attentes et sollicitations médiatiques à leurs endroits leur font perdre toute "originalité" avec le temps. On ne peut pas être deux fois l'outsider.
Dans Ethique et Démocratie, Michel Rocard analysait très bien l'influence des média sur le rythme politique en général et le comportement des politiques en particulier. Sa conclusion est sans appel: les média, dont l'indépendance et le pluralisme sont une garantie de démocratie, sont paradoxalement en train de tuer la démocratie.
20:20 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : média, mitterrand, rocard, asimov
19 avril 2011
La genèse de Dune
A la fin des années quatre-vingt-dix, Brian Herbert et Kevin J. Anderson décident de se lancer dans l’écriture d’une suite de la mythique saga Dune, laissée inachevée par le décès de Frank Herbert en 1986. Mais au lieu d’attaquer directement l’écriture du septième tome, soit la suite de La Maison des Mères, les deux auteurs ont choisi de revenir sur les prémices de la saga.
Dans La Genèse de Dune, leur deuxième trilogie après Avant-Dune, le binôme explique les événements du Jihad Bultérien, la guerre des hommes contre les machines, à l’origine de l’univers politique et économique de Dune. Dans le livre fondateur de la saga, Frank Herbert avait laissé quelques indices sur ces événements déjà millénaires.
Dans ce temps là, les voyages interstellaires sont encore technologiquement limités, l’Epice n’est pas la ressource centrale de l’univers, et les principales institutions connues de la série ne sont pas encore formées. Une partie de l’univers – les mondes synchronisés – est sous la domination des machines d’Omnius, une super intelligence artificielle présente par copies sur toutes les planètes dominée.
Les hommes y sont réduis en esclavage, surveillés par des automates mais aussi les Cymeks, des cyborgs géants abritant un cerveau humain dans des corps mécaniques, alliés d’Omnius. Agamemnon Atréides en est le chef. Vorian, son fils, un humain, assure la remise à jour des copies d’Omnius d’un monde à l’autre. De l’autre côté, les mondes de la Ligue des hommes regroupent les planètes encore libre de la tyrannie des machines. Entre les deux, des planètes dissociées, ni acquis aux robots, ni ralliés aux humains, parmi lesquelles on retrouve Arrakis, la planète des sables.
L’histoire racontera alors cette guerre séculaire entre les humains et les machines, le Jihad Bultérien, du nom de celle qui l’initiera malgré elle. On en apprend plus sur la voyage des Zensunnis, le futur peuple Fremen, la découverte des propriétés de l’Epice, les origines de la Guilde, du Bene Gesserit, des Mentats et de l’Empire des Corino. On découvre pourquoi les Atréides et les Harkonnen finissent par se vouer une haine sans limite.
J’avais lu les deux premiers livres en 2005 et 2006. J’ai terminé le dernier tome il y a quelques semaines. Je ne renouvellerai pas mes remarques sur le style et le schéma narratif des auteurs, rien de nouveau à ce sujet. J’ai trouvé qu’il y a beaucoup de personnages, avec des noms peu mémorisables, qui ont un rôle trop secondaire dans l’intrigue. Du coup beaucoup d’autres personnages manquent de personnalité et de profondeur.
Enfin, alors qu’on connaissait dans les six premiers tomes, les Atréides comme des Justes et les Harkonnens comme des Montres, j’ai trouvé original de faire comme une inversion de situation. L’acte de couardise attribué aux Harkonnens, et à l’origine de leur haine pour les Atréides, en dit beaucoup sur la « raison d’Etat » et la justice du vainqueur. Le héros n'est pas toujours celui qu'on croit.
19:09 Publié dans Livres | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : science-fiction, frank herbert