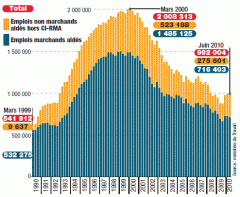05 septembre 2011
La nuit des temps
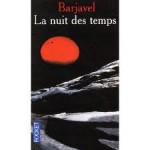 La nuit des temps est un livre de science-fiction, écrit par René Barjavel au milieu des années soixante. Initialement écrit pour un projet cinématographique, l’abandon de ce dernier a poussé Barjavel à transformer le scénario en roman. La science-fiction étant un champ littéraire dominé par des auteurs américains, un chef d’œuvre française du genre méritait bien une note.
La nuit des temps est un livre de science-fiction, écrit par René Barjavel au milieu des années soixante. Initialement écrit pour un projet cinématographique, l’abandon de ce dernier a poussé Barjavel à transformer le scénario en roman. La science-fiction étant un champ littéraire dominé par des auteurs américains, un chef d’œuvre française du genre méritait bien une note.
L’histoire se passe en Terre Adélie, sur le continent Antarctique. Alors qu’ils procèdent à un relevé du relief glaciaire, des scientifiques français enregistrent un signal dont l’émetteur semble situé à 1000 mètres de profondeur. Composée par les plus éminents scientifiques du monde entier, l’Equipe Polaire Internationale (EPI) se met à creuser la terre jusqu’au signal.
Ils découvrent une boulle géante, vielle de plus de 900 000 ans mais produit d’une technologie avancée. En son sein, l’EPI trouve un homme et une femme en parfait état d’hibernation. Après discussions, ils choisissent de réveiller la femme, Elea. Par une technologie télépathique, elle leur montrera la grandeur et la fin tragique de la civilisation Gondawa, son amour pour Païkan, sa présence dans l’Abri etc.
Le récit alterne entre le journal intime de Simon, un docteur de l’EPI tombé sous le charme d’Elea ; le récit de l’expédition des membres de l’EPI venus de tous les continents ; et les souvenirs personnels d’Elea, de sa rencontre avec Paikan à sa mise en hibernation. Mais malgré le souhait de l’EPI de partager cette expérience au monde entier, la découverte de savoirs et technologies avancées suscite bien des convoitises dans un monde en pleine Guerre froide.
Le parallèle entre Gondawa, un peuple intellectuellement et technologiquement avancé mais qui périt par le feu nucléaire, et l’Humanité divisée en 1968 et à la merci d’une nouvelle guerre mondiale, donne une dimension dramatique à l’œuvre. Car ce passé tragique, dont Elea est le témoin, peut tout aussi bien représenter le futur du monde des membres de l’EPI, et partant, celui du lecteur des années soixante (cf. la crise des missiles de Cuba).
L’impuissance des scientifiques d’hier et d’aujourd’hui, ces esprits raisonnables et détenteurs de savoirs universels qui dépassent les clivages idéologiques, à maintenir la paix civile, rajoute une dimension pessimiste à l’œuvre. Mais c’est sans compter sur l’universalité du sentiment de révolte – le roman anticipe mai 1968 – et de l’amour. Car La nuit des temps est avant tout une grande et belle histoire d’amour, le destin d’Elea et de Païkan rejoignant celui des amants légendaires.
J’ai littéralement dévoré le livre, au style clair et poétique, le ton juste et accessible, aux sujets intemporels. Ce qui m’a étonné c’est la facilité avec laquelle on imagine l’univers décrit, que ce soit la partie en Terre Adélie ou Gondawa. C’est avec une émotion particulière que j’ai entrepris de lire ce livre. Il appartenait à ma cousine. Son petit copain le lui avait offert, signé d’un petit mot intime, pendant sa maladie.
10:00 Publié dans Livres | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : science-fiction
02 septembre 2011
Primaire socialiste 2012 (5)
De la question de l’emploi et des contrats aidés.
Interpellé ce matin par la lecture d’un article d’Alternatives Economiques, consacré aux emplois aidés, j’ai eu envie de regarder ce que proposaient les six candidats à la primaire socialiste, sur la question de l’emploi en général. Et à ma grande surprise, surtout au regard du nombre élevé de chômeurs recensé en France et en Europe, le sujet est encore trop peu traité par les candidats.
A cela, deux raisons peuvent être avancés. D’abord, l’économie est bien au cœur des débats (via la démondialisation, la crise des dettes publiques, ou la stratégie de croissance), chacun ayant à l’esprit que sans un rebond durable de l’activité, il n’y aura pas de création d’emplois pour réduire le chômage. Les politiques de l’emploi, complémentaires à une politique de croissance, seraient dès lors secondaires.
Ensuite, la notion d’emploi est aujourd’hui un mot fourre-tout, englobant des problématiques aussi diverses que l’accès (des jeunes, des seniors, des femmes, des handicapés, des chômeurs…) au marché du travail et leur maintient, le niveau de qualifications, le salariat pauvre, la précarité (temps partiel, intérim), les conditions de travail etc., loin d’être délaissés par les candidats.
Nous retiendrons ici la question de l’accès (et le maintien) au marché du travail. En 1997, le PS avait gagné les législatives avec les 35h et les 500 000 emplois jeunes. Pour 2012, face au chômage des jeunes, le projet socialiste prévoit 300 000 « emplois d’avenir » dans les domaines de l’innovation environnementale et sociale. Mais tout juste énoncée, la mesure a été la cible de nombreuses attaques.
Manuel Valls juge archaïque, peu crédible et trop couteux le retour des emplois jeunes et de la retraite à 60 ans. Jean-Michel Baylet s’est également prononcé contre sans donner plus d’explications ou avancer de contre-propositions. Arnaud Montebourg traite la question de l’emploi sous le seul angle de l’immigration légale de travail. Autant dire que ces trois là ne font pas de l’emploi une priorité.
En lien avec sa théorie du care (le soin, l’attention, la solidarité), Martine Aubry promet de créer 300 000 emplois-jeunes (dont 100 000 dès la première année) dans les domaines de l’innovation environnementale et sociale. Ces emplois aidés seraient financés par la suppression des subventions aux heures supplémentaires, décidées par la loi TEPA de 2007.
Pour relier la question de l’emploi des jeunes et celle des seniors, François Hollande propose un contrat de génération. L’employeur s’engage à garder un senior, le temps qu’il parte à la retraite à taux plein, et embauche un jeune de moins de 25 ans pour qu’il acquière l’expérience du senior. En contrepartie, l’employeur est dispensé pendant 3 ans de cotisation sociale sur les deux emplois.
Ségolène Royal formule l’idée d’un pacte de confiance pour l’emploi des jeunes, centré sur l’alternance et l’apprentissage, correctement rémunéré. Elle propose aussi de sécuriser le parcours des jeunes créateurs d’entreprises, en généralisant en région les « ateliers de la création » et les « bourses Désirs d’entreprendre ».
*
(cliquez sur le graphique pour agrandir)
Les principaux éditorialistes, la droite mais aussi une partie de la gauche, ont beaucoup critiqués les propositions d’Aubry et Hollande en matière de contrats aidés qu’il s’agisse de leurs principes, le « retour des vieilles recettes », ou de leur mise en œuvre, « coûts pharamineux pour une efficacité incertaine ». Pourtant, alors que le chômage atteint un niveau quasi-record, le nombre de contrats aidés proposés reste timide.
On trouve beaucoup de défauts/ limites aux contrats aidés : ils seraient couteux pour les finances publiques, ils stigmatiseraient les bénéficiaires en les enfermant dans le cercle vicieux des emplois subventionnés, ils se concentreraient sur des activités essentiellement « improductives » (i.e lié au secteur public), et leurs efficacités en terme de retour à l’emploi, seraient incertains.
Pourtant les emplois jeunes ont pu constituer une véritable première expérience pour tous ses bénéficiaires et faciliter ainsi leur insertion professionnelle. Ils ont aidés au développement de l’économie sociale et solidaire – le tiers secteur – afin de répondre à des besoins nouveaux ou émergents dans un cadre territorial donné. Ils sont un soutien aux familles ou aux personnes trop éloignés du marché du travail. Par les revenus qu’ils dispensent, ils viennent soutenir la consommation donc l’activité.
Depuis quelques années, on réduit drastiquement l’aide au milieu associatif ainsi que le nombre de contrats aidés. Peut être que la situation économique et sociale d’avant crise permettait de stabiliser voir réduire ces dépenses qu’on peut légitimement ne pas vouloir voir perdurer. Mais lorsqu’on subit la pire crise internationale depuis 1930, ne pas jouer sur ce levier, malgré toutes ses limites et imperfections, relève de l’inconscience…
Note 1 : Moscovici, candidat ?
Note 2 : Le PRG participera à la primaire socialiste
19:50 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : aubry, royal, hollande, montebourg, valls, élections, primaires
28 août 2011
Visa pour l’image 2011
Depuis 23 ans, chaque année en cette fin de période estivale, Perpignan accueille le Festival International de Photojournalisme dit Visa pour l’image. L’occasion de revisiter l’actualité de ces derniers mois, riche en événements, les uns chassant les autres à un rythme effréné, mais aussi de découvrir quelques expositions intéressantes.
La première fois que je suis venu, c’était en 2006. Je me souviens encore bien des quelques des expositions que j’avais vu: le commandant Massoud, la région de Tchernobyl et la vie difficile des populations qui y vivent, la Louisiane dévastée par Katrina, le Chili sous Pinochet, l’enterrement de soldats américains tombés en Irak. Pas eu l’occasion d’y retourner depuis.
Mon oncle et ma tante m’ont proposé d’y aller samedi. Timing idéal, c’était le premier jour du festival, du coup pas trop de monde sur les différents sites. Ce qui laisse plus de temps pour apprécier les photos et les sujets exposés. Au-delà des révolutions arabes et de Fukushima, qui ont dominés l’actualité, il y avait des expositions sur la guerre civile au Soudan et en Somalie.
Parmi les thèmes moins actuels, citons les FARC en Colombie, la guerre des cartels au Guatemala, les familles de victimes des guerres des bandes en Californie, Haïti dévasté. Des images très dures parfois. Beaucoup d’émotions « immortalisées » aussi. Je m’attardais parfois à scruter les traits de visages de ces inconnus, victime du destin ou de la nature humaine.
On compte aussi des sujets moins glauques, voir drôles, comme ces barons de la pègre londonienne, maitres de la nuit et de ses excès mais qui frisent presque le cliché ; ou encore ces britanniques lambda en tenue ou position aussi excentriques que ridicules, et dont on aime tant se moquer. Plus apaisant, des photos sous marines de la banquise ou de récifs de corail.
Le thème qui m’a peut être le plus marqué reste les patients des services de psychiatrie chinois, pris en photo entre 1989 et 1990. C’est quasiment des prisons, des lieux d’enfermement où l’on parque les gens plus qu’autre chose. Et la photo qui m’a le plus ému est celle d’une vielle femme et d’un enfant dont elle n’est pas parente, fuyant les combats et la famine au Soudan. J’ai admiré (imaginé) cette sorte d’instinct maternel ou de solidarité.
Sur toutes les photos couvrant les révoltes et les guerres civiles, je me suis beaucoup interrogé sur le regard et l’état d’esprit du photographe. Il y a du courage à côtoyer des guerriers sur le champ de bataille, au péril de sa vie. C’est les lettres de noblesse du photo journalisme. Mais face à la misère, la détresse ou la mort en action, comment réagissent-ils en leur fort intérieur ?
Une interrogation qui m’a fait me rappeler l’histoire du Peintre des batailles, d’Arturo Perez- Reverte, à propos d’un ancien photographe de guerre, désormais reclus dans sa tour d’ivoire en attendant la mort.
20:16 Publié dans Récit de vie | Lien permanent | Commentaires (1)
19 août 2011
Primaire socialiste 2012 (4)
De la légitimité d’une candidature
Avant d’aborder plus amplement les questions de fond et le positionnement politique des six candidats à la primaire des socialistes et radicaux de gauche, il m’a semblé opportun de faire le point sur la légitimité des candidats. Il ne s’agit pas de juger la pertinence et l’intérêt de chaque candidature au regard des enjeux politiques mais d’analyser plutôt la manière dont chacun cherche à légitimer sa candidature.
La première des légitimités en politique reste l’élection. C’est parce qu’on est investie du suffrage universel qu’on est autorisé, pour une période donnée, à parler au nom du collectif et à prendre une décision au nom de celui-ci. Mais on compte aussi l’expérience de responsabilités publiques, l’expertise (savoirs-savants), l’opinion publique (les sondages), le soutiens de personnalités politiques ou de la société civile etc.
Ségolène Royal met en avant son expérience à la tête de la Région de Poitou-Charentes, jouant ainsi la carte de la proximité et de l’innovation de terrain. Alors qu’elle jouissait en 2006 d’une grande légitimité médiatique, elle accuse aujourd’hui un sérieux retard dans les intentions de vote. Sa position à l’égard des média a d’ailleurs profondément changé. Comme pour compenser et se démarquer, elle revendique son expérience de candidate à la présidentielle en 2007.
Plus intéressant encore, ayant été largement attaquée par le passé sur ses compétences et son aptitude à occuper la fonction présidentielle, Royal a multiplié les voyages internationaux (histoire d’acquérir une stature internationale) et les discussions avec de nombreux experts (économistes, sociologues etc) et aime à le faire savoir. Ce faisant on dirait qu’elle délaisse l’expertise citoyenne qu’elle avait tant mise en avant en 2006 et 2007.
Depuis l’éviction de DSK, François Hollande est le nouveau favori des sondages. Ce soutien médiatique est une force dans la course à l’investiture, mais l’histoire a montré que ce n’était pas toujours suffisant. N’ayant jamais exercé de responsabilités ministérielles, il rappelle sa proximité à Jospin lorsque ce dernier était à Matignon. Mais il aime aussi jouer sur son absence d’expérience pour mieux apparaitre comme un homme neuf.
Pour mieux se démarquer de l’actuelle Première secrétaire et répondre à l’accusation d’un PS gauchisé et dépensier, Hollande se présente comme l’homme de la rigueur. Il a mis en avant son bagage intellectuel (HEC, ENA) et son réseau d’experts pour donner du poids à ses idées sur la fiscalité. Il se rêve comme l’héritier de Delors. Et la boutade corrézienne de Chirac le présente comme un républicain ouvert, capable de rassembler au-delà de son camp.
Bien qu’elle ait laissée les rênes du PS à Harlem Désir le temps de la primaire, Martine Aubry joue clairement la carte de la légitimité du parti. C’est moins le statut de Première secrétaire qu’elle met en avant que son bilan à la tête du PS : rassemblement des socialistes après la débâcle des européennes, rénovation du parti, relation avec les experts et intellectuels, travail sur des propositions.
Elle m’apparait comme celle qui revendique et assume le plus le projet des socialistes, voté en mai dernier. Sa stature internationale, elle l’a forgée en rencontrant d’autres chefs de partis en Europe (SPD, Parti Démocrate), et en signant avec eux des engagements communs pour l’avenir. Son équipe de campagne a fait le plus de place aux personnalités de la société civile (intellectuels, gens de la culture ou du mouvement social). Elle jouie aussi d’une longue expérience ministérielle et d’élue de terrain.
Du côté des « petits » candidats, Baylet a pour lui ses expériences ministérielles et d’élu local (Conseil général) mais c’est bien son statut de Président du PRG qui justifie sa candidature. Manuel Valls a lui le soutien de nombreux élus locaux et met en avant le fait qu’il soit lui-même maire d’une commune populaire. Il joue la carte de la nouvelle génération et de sa non-participation aux gouvernements Jospin pour apparaitre comme nouveau.
Montebourg joue la carte de la rénovation du PS (primaires, règle du mandat unique), dont il revendique la paternité, et du profil différent (c’est un avocat, plutôt jeune) et des propositions spécifiques (démondialisation, VIème République, capitalisme coopératif) qu’il défend. Il a reçu le soutien, tantôt public, tantôt à demi-mot, de responsables politiques de la gauche (Tobira, Mélenchon, Chevènement, chez les Verts).
Note 1 : Moscovici, candidat ?
15:38 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aubry, royal, ps, dsk, hollande, jospin, montebourg, mélenchon, valls, primaires
17 août 2011
Le facteur ascension
 Il s’agit du quatrième et dernier tome de la série « Le Programme conscience ». Décédé en 1986, Frank Herbert n’a pas participé à sa rédaction. Bill Ransom explique toutefois dans une courte préface, qu’il a écrit le livre à partir du scénario co-rédigé avec Frank Herbert. Mais à aucun moment le style diffère des autres tomes.
Il s’agit du quatrième et dernier tome de la série « Le Programme conscience ». Décédé en 1986, Frank Herbert n’a pas participé à sa rédaction. Bill Ransom explique toutefois dans une courte préface, qu’il a écrit le livre à partir du scénario co-rédigé avec Frank Herbert. Mais à aucun moment le style diffère des autres tomes.
Vingt cinq ans ont passés depuis les événements rapportés dans L’effet Lazare. Les capsules d’hibernation, laissés en orbite de Pandore par Nef lors de son départ à la fin de L’Incident Jésus, ont étés récupérées. Parmi les clones humains qu’elles abritaient, on retrouve Flatterie le psychiatre-aumônier de Destination Vide.
La renaissance du varech, cette étrange espèce végétale aquatique aux pouvoirs surnaturels, a permis à nouveau le contrôle des courants des océans et l’émersion de continents, sur lesquels Iliens et Siréniens se sont installés. Mais le varech n’a pas encore atteint le statut d’Avata, et les hommes tentent de limiter son extension.
Flatterie a mis en place une dictature impitoyable, basée sur la répression armée, le rationnement alimentaire des populations et le contrôle de l’information. Il s’attaque aux superstitions des populations à l’égard du varech dont il souhaite contrôler l’extension. Il entreprend la création d’une navette spatiale et d’une I.A. pour quitter Pandore.
Tous les espoirs sont placés en Crista Galli, une jeune femme sortie de la profondeur des eaux, prisonnière de Flatterie. Quand Ben et Rico, membres des Enfants de l’Ombre (la résistance) réussissent à l’enlever, Nervi, l’homme de mains de Flatterie, part à leur poursuite. La chasse à l’homme commence. L’avenir des Pandoriens et d’Avata en dépend…
Ce dernier tome m’a semblé de moins bonne facture que les précédents. L’histoire tarde vraiment à se mettre en place. Des chapitres viennent décrire la difficile vie quotidienne des humains mais apportent peu à l’histoire. Les personnages principaux sont très peu attachants, alors que certains personnages, presque figuratifs, auraient du être exploités.
J’avoue que le cadre général ne m’a pas convaincu d’entrée. Le retour de Flatterie, dans le rôle du Directeur criminel, cynique et paranoïaque qui n’est pas sans rappeler Morgan Oakes, m’a surpris et déçu. On comprend tardivement sa fonction de système de sécurité mais une personnalité plus complexe et nuancée lui aurait donné plus de profondeur.
Par ailleurs, l’histoire se passe 25 ans après L’Effet Lazare. Or je suis surpris qu’en si peu de temps, la civilisation sirinienne ait complètement disparue, et que l’humanité, nouvellement installée sur les terres émergées, puisse bâtir des citadelles si grandes et technologiquement avancées. Disons que la transition entre les deux périodes est mal assurée.
L’intérêt du livre est toutefois de conclure, tout en ménageant une possible suite que Bill Ransom semble avoir exclu, la saga « Le Programme conscience ». C’est moins la création ou constitution d’une conscience artificielle ou supernaturelle qui compte ici que la prise de conscience par les humanoïdes de Pandore – mutants, « normaux », clones – de leur humanité, et de l’importance des liens qui nous unissent.
14:58 Publié dans Livres | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : science-fiction, frank herbert