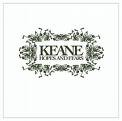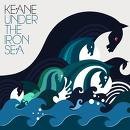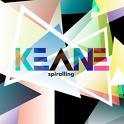29 décembre 2008
Quête Macabre
« Deux jeunes gens viennent passer un séjour à la montagne, dans la maison héritée de l’oncle de l’un deux, décédé quelques mois plus tôt. En fouillant la maison, ils trouvent un porte document. Celui ci rassemble toutes les recherches qu’avait effectuées le défunt, pour retrouver une amulette magique. Une amulette ayant appartenu à un templier, brûlé sur un buché. Ils se lancent alors à la recherche du médaillon qui se trouve être enterré aux alentours d’une chapelle. Ils finissent par trouver et piller la tombe. Mais ils vont très vite se rendre compte qu’on ne réveille pas les morts impunément… »
Inspiré de la nouvelle « Le Molosse » d’Howard Philip Lovecraft, Quête Macabre est le troisième court métrage que j’ai réalisé avec Laurent et son frère, il y a deux ans de ça. Avec les deux autres, Nuit Sacrée et Le Sentier, ils constituent une sorte de trilogie « fantastique » du « Moine fou ».
Tournés dans les Pyrénées, à proximité d’une église, d’un vieux moulin ou d’une chapelle, avec une simple caméra et dans des décors naturels comme la montagne et la forêt, ces trois courts-métrages sont des films amateurs. A partir de l’expérience cinématographique acquise par Laurent aux Beaux Arts de Metz, nous avons bien cherché à respecter certaines « conventions », à nous appliquer le plus possible à chaque prise, ou encore à exploiter un logiciel de montage pour améliorer le film. Mais notre équipe, si réduite, et nos faibles moyens (matériels, financiers) ne nous ont pas permis de faire plus.
Cette envie de faire des films est née bien avant ces trois courts métrages. Il y a un peu moins de dix ans de ça, alors que nous n’étions qu’au collège, j’avais lancé la folle idée de tourner un mini épisode de Star Wars.
Au départ, il s’agissait de faire une sorte de bataille spatiale. Nous avions fait des vaisseaux en terres, avec un trou à l’arrière pour mettre un pétard, sur lesquels nous mettions un coup de peinture. On avait trouvé une boule en polystyrène qu’une couche de white, si je me souviens bien, avait attaqué, donnant au final l’aspect de Lune. Nous avions fait aussi les fameux destroyeur impériaux à partir de cartons. En fait, on gardait les pots de yahourt, les cartons des boites de kellogs, les tubes de dentifrice, des petites bouteilles, et autres substantiles pour créer des vaisseaux (ou des lunettes).
Puis un ami vint nous dire que Star Wars sans combat de sabre lasers, c’était pas Star Wars. Je le pris aux mots et rédigea l’ébauche d’un scénario, que j’améliorerai par la suite par sept versions, et qui intégrait un duel de Jedi. Le scénario plus ou moins fini, nous recherchions du monde intéressé par le projet. Face au problème crucial d’argent, qu’une participation de tous ne résolvait évidemment pas, Laurent proposa de participer au concours sciences vie junior. Nous envisagions alors de constituer un mini-robot R2D2, à partir d’un petit tonneau et de quelques moteurs. Quelques années après j’avais même constitué un début du dôme. Des masques devaient aussi être crées.
Mais comme quelques mois après je dû partir en Afrique et que chacun alla dans un lycée différent, le projet entra en sommeil. De Djibouti, je continuai à améliorer le scénario et à rédiger une bonne partie des dialogues des différentes scènes. Laurent découvrit de son côté un logiciel de 3D qui nous serait utile pour les scènes de vaisseau. Ensemble, dans les Pyrénées, nous avions inventé, geste après geste, la scène du duel. Puis à mon retour définitif d’Afrique, le projet fût officiellement abandonné, par manque de temps, par réalisme, par abandon successif des (bonnes) volontés des membres de l’équipe.
Si au final il reste un goût amer d’inachevé (les mauvaises langues diront que ça n’avait même pas commencé), je ne regrette pas le temps investi dans une telle aventure. J’ai d’ailleurs beaucoup appris de cette expérience : appris sur les difficultés à rédiger (je crois que mon goût de l’écriture vient de cette période là), à animer et motiver dans la durée une équipe, à identifier les contraintes (financières, techniques, technologiques) et les moyens de les résoudre, et tout simplement à faire des allers retours entre ce qu’on imagine et ce qu'on souhaite (par définition personnel) et ce qui est en réalité et en pratique faisable.
Mais je continue à rédiger, à mes heures perdues, des débuts de scénario. Hélas je n'ai pas toujours l'inspiration pour les finir. Un autre jour, je vous en présenterai peut être... Des masques devaient aussi être crées.
Si au final il reste un goût amer d’inachevé (les mauvaises langues diront que ça n’avait même pas commencé), je ne regrette pas le temps investi dans une telle aventure. J’ai d’ailleurs beaucoup appris de cette expérience : appris sur les difficultés à rédiger (je crois que mon goût de l’écriture vient de cette période là), à animer et motiver dans la durée une équipe, à identifier les contraintes (financières, techniques, technologiques) et les moyens de les résoudre, et tout simplement à faire des allers retours entre ce qu’on imagine et ce qu'on souhaite (par définition personnel) et ce qui est en réalité et en pratique faisable.
Mais je continue à rédiger, à mes heures perdues, des débuts de scénario. Hélas je n'ai pas toujours l'inspiration pour les finir. Un autre jour, je vous en présenterai peut être...
Si au final il reste un goût amer d’inachevé (les mauvaises langues diront que ça n’avait même pas commencé), je ne regrette pas le temps investi dans une telle aventure. J’ai d’ailleurs beaucoup appris de cette expérience : appris sur les difficultés à rédiger (je crois que mon goût de l’écriture vient de cette période là), à animer et motiver dans la durée une équipe, à identifier les contraintes (financières, techniques, technologiques) et les moyens de les résoudre, et tout simplement à faire des allers retours entre ce qu’on imagine et ce qu'on souhaite (par définition personnel) et ce qui est en réalité et en pratique faisable.
Mais je continue à rédiger, à mes heures perdues, des débuts de scénario. Hélas je n'ai pas toujours l'inspiration pour les finir. Un autre jour, je vous en présenterai peut être...
Si au final il reste un goût amer d’inachevé (les mauvaises langues diront que ça n’avait même pas commencé), je ne regrette pas le temps investi dans une telle aventure. J’ai d’ailleurs beaucoup appris de cette expérience : appris sur les difficultés à rédiger (je crois que mon goût de l’écriture vient de cette période là), à animer et motiver dans la durée une équipe, à identifier les contraintes (financières, techniques, technologiques) et les moyens de les résoudre, et tout simplement à faire des allers retours entre ce qu’on imagine et ce qu'on souhaite (par définition personnel) et ce qui est en réalité et en pratique faisable.
Mais je continue à rédiger, à mes heures perdues, des débuts de scénario. Hélas je n'ai pas toujours l'inspiration pour les finir. Un autre jour, je vous en présenterai peut être...
20:23 Publié dans Récit de vie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pyrénées
12 décembre 2008
L'épreuve du miroir
Ces dernières semaines, comme ça arrive à tout un chacun dans sa vie au quotidien, j’ai connu des hauts et des bas, j’ai passé des jours avec et des jours sans. En repensant à ces sautes d’humeurs, qui peuvent se succéder dans la même journée, je me fascine du mystère des méandres de l’âme. Il est assez difficile pour les expliquer de distinguer ce qui vient de l’environnement collectif dans lequel on baigne, de ce qui a trait à sa propre personnalité.
Cette année universitaire est censé être notre dernière année d’étude. J’ai le sentiment que pour beaucoup de monde, quelque soit le module choisit, c’est une année de trop. Pourtant, je trouve paradoxal de voir la saturation de certains amis par rapport à cette année studieuse supplémentaire, au regard de leur difficulté à se projeter dans l’après, c'est-à-dire leur vie professionnelle. Pour beaucoup, il semble que « demain est un autre jour ».
Je suis dans une filière qui prépare aux concours de la haute fonction publique. En discutant avec les uns et les autres, il ressort une impression de frustration collective. Une frustration qui cache autant une certaine insatisfaction par rapport à l’enseignement reçu et à l’(in)organisation de la filière, qu’une certaine incertitude par rapport à l’avenir. Entre la crise économique et financière qui assombrie les perspectives professionnelles et les divers chamboulements, décidés par l’actuelle majorité politique, en vue de transfigurer l’Etat (et donc ça concerne les concours d’accès aux métiers de celui-ci), on a l’impression qu’on arrive au mauvais moment.
Alors que nous sommes appelés peu ou prou à être les futurs représentants de l’élite administrative et politique de ce pays, ma génération est comme qui dirait, atteint de sinistrose. Ma génération a peur de l’avenir, peur du monde qui vient. Symptôme d’une société en perte de sens, et qui ne sait plus imaginer et donner une perspective à sa progéniture. Symptôme, peut être, d’une génération narcissique qu’on a plus ou moins trop bien couvé et qui se réveille soudainement. Symptôme, peut être, d’une crise même des élites, à supposer bien sûr qu’on accepte cette terminologie pour une (petite) bourgeoisie de province, classes moyennes à la dérive, que nous sommes. Il faut savoir passer l’épreuve du miroir, tout en sachant qu’un miroir ne reflète qu’un reflet, qu’une image possible….
A mon niveau, j’ai le sentiment d’être complètement décalé, trop souvent décalé. Non que je ne connaisse pas les doutes et inquiétudes de mes camarades, leurs interrogations sont aussi les miennes, car j’ai aussi mes propres démons… La vérité, c’est que je me rends compte d’un certains nombres de choses sur mes compagnons de promo qui sont, comme le dit une amie, à vous faire désespérer de la nature humaine.
D’abord, notre incapacité à travailler en groupe. Il nous a été sommé de faire 5,6 groupes de six afin de travailler les différents exposés. Riche expérience que celle-ci. Je ne connais presque pas de groupe où les membres ne s’entendent pas super bien. Une amie vient de tomber dans une quasi dépression parce qu’elle a été mis à l’écart par les gens de son groupe et que ceux-ci n’ont pas hésité à lui faire maintes réflexions désobligeantes. Moi-même, je me suis pris le bec avec certaines filles de mon groupe. Toujours des problèmes de communication et d’esprit collégial entre les singes que nous sommes. Et puis certain(e)s ont trop le goût du leadership. Quand dans certaines prépas, on organise des soirées à thèmes sur telle ou telle discipline, nous on daigne s’envoyer quelques mails et nos parties d’exposés sans vraiment lire celles des autres. Je me souviendrai toujours de cette phrase d’un prof de socio « Un français est plus productif qu’un japonais. Mais dix japonais qui travaillent ensemble sont plus productifs que dix français ensemble».
En début d’année, on nous a encouragés, via la constitution des groupes, à partager entre nous, par voie orale ou par mail, toute information susceptible d’aider tout le groupe. La direction souhaitait voir émerger une émulation collective. Mais comme nous passons des concours différents, nous n’avons pas les mêmes objectifs. On se demande nos notes pour se comparer et voir qui est un possible concurrent. En quatrième année, une fille avec qui j’ai commencé par sympathiser par un simple sourire et un simple bonjour, m’a dit que chez elle, certains travaillaient peu au sein des groupes pour mieux bosser de leurs côtés pour les concours.
Incapacité de coopérer. Pas plus tard que hier j’ai demandé, par mail, à ce qu’on s’envoie nos exposés en vue de la semaine de concours blanc de la semaine prochaine. J’ai donné l’exemple en envoyant deux des exposés de notre groupe. Tous ne jouent pas le jeu, loin de là ! Triste exemple de la théorie du passager clandestin…. Par ailleurs, nous avons avec nous des prep’externe qui ne sont pas dans nos listes de mails. Et quand j’ai vu l’une d’entre eux s’acharner à prendre des notes de nos exposés, je me suis rendu compte qu’ils ne recevaient pas nécessairement nos mails. Je lui ais proposé de le lui envoyer, en lui recommandant d’envoyer les docs aux autres. Pareil, j’essaye d’envoyer mes notes à cette amie malade le plus souvent possible, qui, touchée par cette délicate attention, se confie à moi alors que nous n’étions pas bien proche avant
Mais si je me sens parfois décalé par rapport à mes semblables, on me dit aussi décalé par rapport à d’autres. Cet après midi, j’ai retrouvé la nouvelle monitrice de mon autoécole dans le bus. Et en discutant elle me faisait part de son insatisfaction dans ce job qu’elle venait tout juste de commencer. Elle m’explique son projet d’apicultrice et le combat « politique » qui va avec. Elle a montée des ruches sur un terrain que des amis mal-logés squattent. Elle m’avoue alors être énervée par l’aspect très bourgeois, très classe moyenne, de ses élèves. « Tous des clones » disait-elle. Ils sont pas « naturels » dans leur comportement, tranchait-elle. J’essayais de les excuser mais elle en rajoutait une couche en faisant une comparaison avec son expérience sur Paris et Lyon. Et là elle me sort que je fais partie des 10% à être naturels… Je fais mon sourire en coin de toujours mais dans ma tête c’est confus. C’est un étrange compliment, si compliment il y a. Elle connait aussi mon parcours scolaire et mes objectifs professionnels.
Et maintenant je débranche mon cerveau et m’éloigne du miroir… dans tous les sens du terme ;-)
23:13 Publié dans Récit de vie | Lien permanent | Commentaires (15)
05 décembre 2008
Huesos - Pedro Guerra
J'ai trouvé cette vidéo sur le blog du camarade Oscar Cerezal.
Je reviendrai sur le sujet des fosses communes en Espagne.
En attendant, j'écoute la musique j'en ais les larmes aux yeux...
19:57 Publié dans Réflexion du jour | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : espagne, mémoire
23 novembre 2008
Nouvel album de Keane
01:07 Publié dans Musique | Lien permanent | Commentaires (9)
04 novembre 2008
75ème Congrès du PS (3)
Dans cette troisième note sur le congrès de Reims, je m’attarderai sur deux thèmes de réflexions qui m’occupent l’esprit depuis quelques jours : la question du leadership d’une part et l’étrange notion de « guerre de religions » au PS d’autre part.
Le leadership.
Avant que la crise financière ne finisse par éclipser le congrès du PS comme sujet d’actualité, les média s’intéressaient à la bataille interne des socialistes uniquement sous l’angle du leadership. Pour eux un parti est inaudible parce qu’il n’a pas de leader. Les questions de programme, de propositions, de méthode les importent bien peu, encore plus quatre ans avant les prochaines présidentielles. Soit...
Depuis un certain temps déjà, je m’interroge sur la notion de leader et sur le rôle qu’il doit occuper dans une organisation (comme l’est le PS) et le fonctionnement de celle-ci. Ni adepte de l’autogestion comme mode organisation sociale par excellence, ni pourfendeur pavlovien de l’autorité, j’ai malgré tout un mal fou à comprendre le besoin de « chefitude » que certains aiment exprimer sur d’autres, et dans lequel d’autres ont besoin de se placer vis-à-vis de certains. Autant par respect des conventions sociales je me soumets aisément au rapport d’autorité (étudiant vis-à-vis du professeur, malade vis-à-vis du docteur, enfant vis-à-vis des parents etc), autant je n’aime pas me faire commander.
Mais qu’est-ce qu’un leader ? Deux réponses me viennent en tête : une personne qui occupe un poste clé dans une organisation hiérarchique donnée et/ou une personne qui montre une capacité certaine d’influence et d’animation d’un groupe donné. Alors que le premier tire sa qualité de leader de la légitimité d’un poste ou d’un statut, le second la revendique de l’expérience sociale. Biens sûr il y a surement d’autres définitions plus appropriées.
Les principaux candidats plus ou moins déclarés au poste de Premier secrétaire conçoivent différemment le leadership. Bertrand Delanoë et Ségolène Royal me semble vouloir accéder au poste Premier secrétaire pour revendiquer le « leadership bureaucratique » comme source de leur autorité politique. Ils mettront en avant le vote des militants et/ou le ralliement des responsables fédéraux comme source de légitimité. Martine Aubry semble concourir au « leadership bureaucratique » pour mieux mettre en valeur son « leadership de la pratique sociale ».
Sur le rôle du leader dans l’organisation et le fonctionnement du PS, là aussi on note des divergences. Royal envisage(ait) de créer une sorte de dyarchie politique au PS : elle serait présidente du parti avec en dessous une sorte de secrétaire général qui s’occuperait, avec une direction pleine de nouvelles têtes, des affaires internes du PS pendant qu’elle parlerait aux « vrais gens ». Delanoë a une vision plus managériale : il faut un « vrai » chef qui sache initier des projets et trancher les décisions, un chef accompagné d’une direction resserrée où les gens ont intérêt à se bouger le fion s’ils veulent rester en place. Une véritable culture du résultat en somme. Martine Aubry semble privilégier une direction plus collégiale où on fixerait ensemble la position du PS et on la défendrait ensemble à l’extérieur.
Cependant entre ce que les trois affichent et ce qu’ils feront effectivement demain s’ils sont à la tête du PS, il peut y avoir des écarts abyssaux. Pour l’instant je me sens proche de la conception collégiale de la motion D. Je conçois le Premier secrétaire comme une sorte de super animateur, capable de faire travailler collégialement une majorité des forces du parti dans une direction et un secrétariat général rénové, resserré et qui sert à quelque chose.
« Guerre de religions » au PS
L’expression sonne mal lorsqu’on la rapproche du nom d’un parti politique laïc. Mais elle a un sens. La réflexion qui suit se base sur les propos entendus d’un intervenant de l’émission politique « Déshabillons-les » de la chaine LCP. L’émission que j’avais vu concernait le style Aubry, jugé comme « l’anti-Royal ». Les commentateurs analysaient les différences des mots employés, des expressions faciales et autres entre les deux dames du PS.
Puis j’ai entendu un « Aubry fait partie des hollandais ». Ce n’était pas une référence à François Hollande, le premier secrétaire du PS, mais à la culture protestante. Ce qui m’importe ici c’est moins la pratique religieuse de tel ou tel responsable politique, que le lien entre la culture peu ou proue religieuse et la pensée politique. Car mon sentiment est que la culture religieuse dans laquelle on baigne plus ou moins dans sa jeunesse structure pour partie (et seulement pour partie, je me garde bien de tirer des relations de causes à effet), la manière qu’un individu a de penser, de vivre et de faire la politique.
Bien qu’on observe depuis une trentaine d’année un recul du fait religieux dans notre société, l’histoire montre que politique et religion se croisent. La sociologie électorale met en évidence la tendance politique de chaque communauté religieuse (à noter que les tendances évoluent dans le temps et dans l’espace) et l’étude de l’histoire des idées ne peut faire l’impasse sur l’apport des religions et de leur contestation.
Au risque de faire trop de raccourcis schématiques, l’histoire tend à montrer que le protestantisme, par ses origines mêmes, constitue une certaine forme de pensée critique alors que le catholicisme (et ses institutions) rejoint les forces conservatrices (*). On voit que les deux religions, tout en partageant un tronc commun, n’utilisent pas vraiment le même modèle de pensée et ne privilégient pas les mêmes valeurs.
La culture protestante se base pour l’essentiel sur les notions d’individualisme et de responsabilité. La grande place accordée à l’individualité conduit naturellement à la reconnaissance et à la défense de libertés, notamment politiques, par rapport au pouvoir arbitraire du souverain puis de l’Etat. La responsabilité, qui vient du refus du concept du « pêché avoué à demi pardonné » de l’Eglise catholique (**), va déboucher sur les valeurs de probité et d’éthique : il faut être irréprochable, l’austérité et l’ascétisme sont de mises et l’expression des sentiments réprouvé (***). Par ailleurs, le protestantisme s’accompagne de la distinction entre le bien et le juste ce qui amène à une autre conception de la justice que celle de la pensée catholique.
De son côté, la culture catholique privilégie la notion de communauté qui dépasse les individus qui la compose en même temps qu’elle écarte (par la violence physique ou symbolique) ceux n’en faisant pas partie. Elle exprime un certain attachement à l’ordre moral et au respect de celui-ci. L’apparence et le symbolique sont très importants. L’humilité et la compassion sont mises en avant.
C’est par ces différences de culture politique, que des gens comme Michel Rocard et Lionel Jospin ne s’entendent pas bien avecdes Ségolène Royal et d’autres. A côté de ces deux cultures fortement inspiré par des valeurs peu ou prou religieuses, je note une troisième culture, plus républicaine et libérale, que représente DSK.
(*) Lorsqu’on regarde nos voisins européens on remarque que les protestants sont plutôt sociaux-démocrates et les catholiques plutôt conservateurs.
(**) Il se matérialise sur le principe : des dons contre ton salut.
(***) Ces valeurs seraient à l’origine du capitalisme.
23:14 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : ps, média, dsk, rocard, jospin, royal, aubry